BL: Bonjour Monsieur Théo Ananissoh. Vous êtes écrivain togolais. Et vous vivez à l’extérieur. Pourriez-vous retracer pour nous votre itinéraire?
TA: Douze ans en Centrafrique où je suis né de parents togolais. Encore exactement douze autres années au Togo. Huit années ensuite en France pour des études de lettres. Et vingt-cinq ans en Allemagne. J’ai appris à passer d’une culture, d’une langue à une autre, tout en gardant deux repères essentiels : le Togo, lieu de mes origines, et la littérature.
BL : Qu’est-ce qui justifie le choix de « l’ailleurs »? L’ailleurs est-il toujours meilleur, quand on sait que le Togo a besoin de ses fils, tous ses fils pour « mieux respirer » et mener à bien le combat pour la liberté et l’égalité pour tous?
TA : Ce n’est pas un choix, l’ailleurs, en ce qui me concerne. Des nécessités successives. Mon grand-père a émigré du Togo vers l’Afrique centrale. Le Cameroun d’abord, puis la Centrafrique. Mon père, né au Togo, a suivi mon grand-père. Je suis né en 1962. Je serais resté ou devenu centrafricain comme plusieurs de mes oncles et cousins si le régime de Bokassa n’avait pas incité mes parents à retourner au Togo. Quant à la France, je voulais devenir écrivain, et cela suppose des études d’une certaine qualité, de bonnes lectures, un contexte où, d’un point de vue social, cela a un sens d’écrire des romans et d’en lire…. Je parle d’une époque d’avant l’Internet. Je vis en Allemagne parce que j’ai eu en 1994 la possibilité d’y enseigner à l’Université. Cela dit, je rentre chaque année au Togo et pour l’avenir, si j’ai le bonheur d’avoir du temps et de la santé, je compte m’y investir concrètement et intellectuellement.
BL : Deux de vos personnages, Zupitzer et Eric Bamezon, nous paraissent comme le prototype de ces intellectuels qui ont comme la haine de l’Afrique. Mais, contrairement à Eric Bamezon, Zupitzer, à sa manière, porte la cause du peuple en allant jusqu’à tuer le colonel Katouka, beau-frère du président à vie de la nation. Geste incompréhensible. Indépendamment de la compréhension que nous en avons, nous autres lecteurs, que voulez-vous exprimer, cher Théo Ananissoh, à travers ces deux personnages?
TA : Non, Zupitzer et Bamezon n’ont pas la haine de l’Afrique ! Non. Ils ont mal à l’Afrique, disons. Ils en souffrent. C’est exactement le contraire. Zupitzer éprouve sans doute de la rage contre l’état des choses et des êtres. Bamezon, plus intellectuel, aussi à sa façon.
BL : Pourriez- vous nous en dire un peu plus sur votre roman « Un reptile par habitant » ? D’abord, dites-nous un mot sur le titre dont aucun mot ne transparaît presque nulle part dans le livre. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman ?

TA : Ce roman m’a été inspiré par les propos d’un monsieur qui fut autrefois ministre dans les premières années d’indépendance du Togo. A un déjeuner qui nous réunissait à Lomé, il a dit qu’il y avait, dans le gouvernement de Nicolas Grunitzky auquel il participait, un autre ministre qui rapportait à une ambassade étrangère tout ce qui se décidait lors des conseils des ministres. Cet homme a été ensuite récompensé par un poste en Suisse dans une des institutions de l’ONU. Pensez la chose avec moi : voilà un traître patenté. Son ancien collègue qui m’en informe le sait, le voit vivre et faire carrière tranquillement puis jouir paisiblement de ses gains dans une belle villa jusqu’à une mort tout aussi paisible. J’ai donc imaginé Zupitzer sur son chemin. « Un reptile par habitant » signifie simplement que tout le monde rampe. Qu’il y a autant de reptiles que d’habitants.
BL : Pensez- vous, comme Zupitizer, l’un des personnages de votre roman, que les citoyens doivent se faire justice eux-mêmes en tuant les hommes politiques qui font régresser la société ?
TA : A chacun sa conclusion après ce que je viens de dire.
BL : Contrairement à « Un reptile par habitant » où à travers le personnage de Zupitzer, on a vu le peuple se débarrasser de l’un de ses bourreaux, « Ténèbres à midi » exhale comme un air de tristesse ou de défaitisme qui une fois encore contraste avec la réalité que vit le peuple assoiffé de délivrance. Pensez-vous que la vie des peuples opprimés (ils sont toujours au cœur de vos écrits) oscille entre ces sentiments de révolte et de soumission toutes à la fois?
TA : Il y a une rage noire dans « Ténèbres à midi ». Quelque chose de concentré et de triste, oui. Un refus catégorique. Il est intéressant que vous associiez sans cesse Zupitzer et Bamezon. C’est que vous sentez leur proximité : leur refus intransigeant, leur refus de ramper. Bamezon n’est pas défaitiste. Je voudrais me souvenir ici d’une phrase de Chateaubriand dans ses « Mémoires d’outre-tombe » : « Mieux vaut perdre la vie que de la demander ».
BL : Une des paroles « fortes » de Sonia dans « Delikatessen », votre dernier roman est : « Le sperme des hommes est nocif ». Et si vous nous plongiez dans l’univers « secret et intime » qui a généré une telle phrase?….
TA : Là aussi, il s’agit d’une rage. Féminine contre les hommes. J’ai remarqué que les femmes en Afrique se plaignent beaucoup des hommes sur le plan intime. Quant aux mots que vous citez, ce sont ceux des personnages tels qu’ils sont.
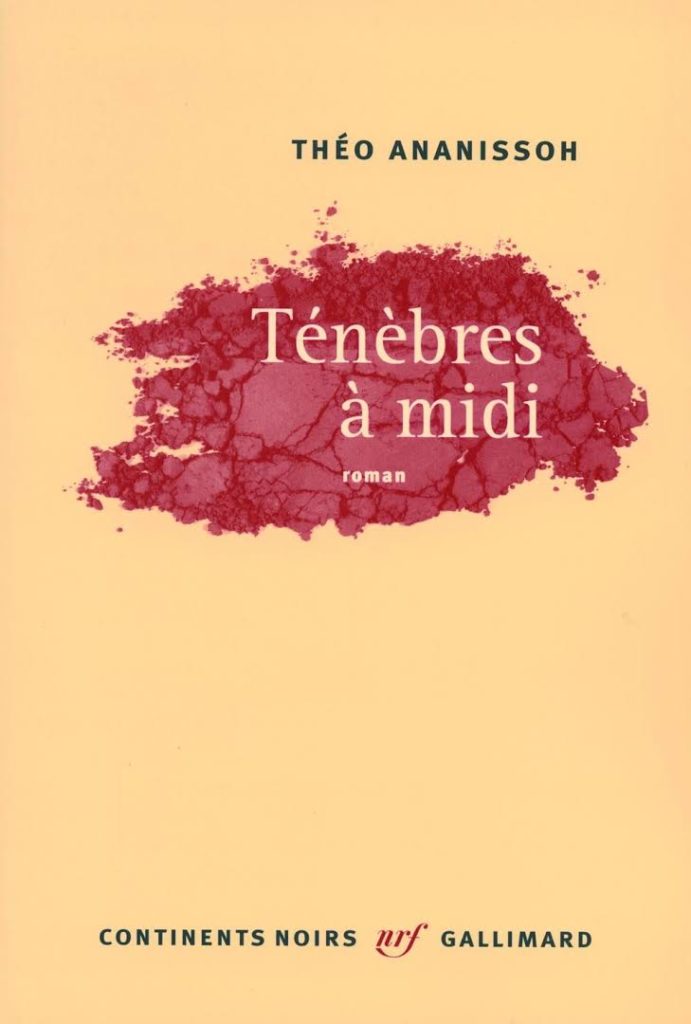
BL : Dans « Delikatessen », l’on voit un Théo Ananissoh enragé, très engagé, qui prend vraiment partie pour le peuple togolais. Mais celui qui vit à l’extérieur, comment peut-il sentir dans sa chair ce que subissent les victimes des exactions de ces » Des eunuques vêtus d’or et de diamant », ainsi que vous décrivez les gouvernants?
TA : Votre question laisse supposer que vous ignorez ce que c’est que vivre chez les autres, loin de chez soi. L’exil, c’est bien souvent la souffrance d’un éloignement, éloignement de sa famille, des lieux de son enfance, et un déclassement social, etc. Dans le roman, à un moment donné, le narrateur rapporte cette pensée d’Énéas : « L’exil est un arrachement à soi. » En Europe, je ne vois sans cesse que des Africains quasi obnubilés par leur Afrique. Ils ne s’en rendent pas tout à fait compte, mais l’Afrique, au fond d’eux, est l’aune à laquelle ils mesurent ou apprécient tout. Ce qui est normal.
BL : De Zupitzer à Enéas, en passant par Eric Bamezon, une même tragédie liée aux mouvements migratoires, à l’exil volontaire ou forcé. Et la conclusion éclate comme un abcès mûr: « Cette fuite obligée […] permet la confiscation de cette terre. […] Les ignorants au pouvoir, les intelligents contraints à l’exil. ». On y sent la douleur de l’écrivain dont la vie est comme celle de Eric Bamezon et de Enéas. Il y a certainement un peu de lui en eux. Mais est-ce que les intellectuels ne trahissent pas leur mission s’ils laissent « cette terre » aux mains des ignares ?
TA : Tout dépend de chacun. Il y a des gens d’esprit qui font défection. Les « Francophones » en particulier. J’ai remarqué qu’il y a, sans qu’ils s’en rendent compte là aussi, des écrivains africains de France ou d’Europe, si j’ose dire. L’Afrique ou leur part d’Afrique, peu ou prou, est un matériau d’origine pour des écrits destinés à un autre monde. Et fort logiquement, ces personnes accordent extrêmement d’importance à l’opinion de leurs interlocuteurs occidentaux, situation gratifiante d’une certaine façon, cela dit : prix littéraires, invitations, etc. (L’appétence de reconnaissance est inhérente à l’activité d’écrivain.) Je pense qu’il faut faire des allers et retours sans cesse. Il importe d’avoir son territoire humain qui ne soit pas d’emprunt. Les humains ont deux modes d’être qui ne sont pas séparés ou séparables : la réalité et l’imaginaire. Je dirais même que l’imaginaire l’emporte sur le réel dans la vie de chacun. Il appartient aux écrivains, aux romanciers dont l’activité est dimaginer de nourrir, de créer cet imaginaire de nous-mêmes. Ainsi, ils créent et affirment leurs propres lieux, leur pays respectifs. Pour ce faire, il faut revenir chez soi, s’en imprégner, se l’approprier sans cesse. Il n’y a aucune place pour nous ailleurs que chez nous.
BL : Monsieur Théo Ananissoh, vous avez choisi le 05 Octobre 2017 pour lancer votre dernier roman. Et on sait aussi que ce même jour, sont matées dans le sang, les manifestations légitimes du peuple togolais descendu dans les rues pour réclamer un peu plus de liberté et de respect de leur personne. Quel sens donnez-vous à cette coïncidence de date?
TA : Ce n’est pas moi qui ai fixé la date de parution de mon roman. C’est l’éditeur. Mais, oui, ce fut une coïncidence bien agréable. 05 octobre 1990, puis 19 août 2017, sont des dates aiguës dans la lutte incessante depuis bientôt trente ans des Togolais pour se libérer d’un régime abject et extrêmement méprisable. Publier un roman un 05 octobre, c’est un peu comme poser une fleur sur les tombes de tous ceux qui sont morts jusqu’ici.
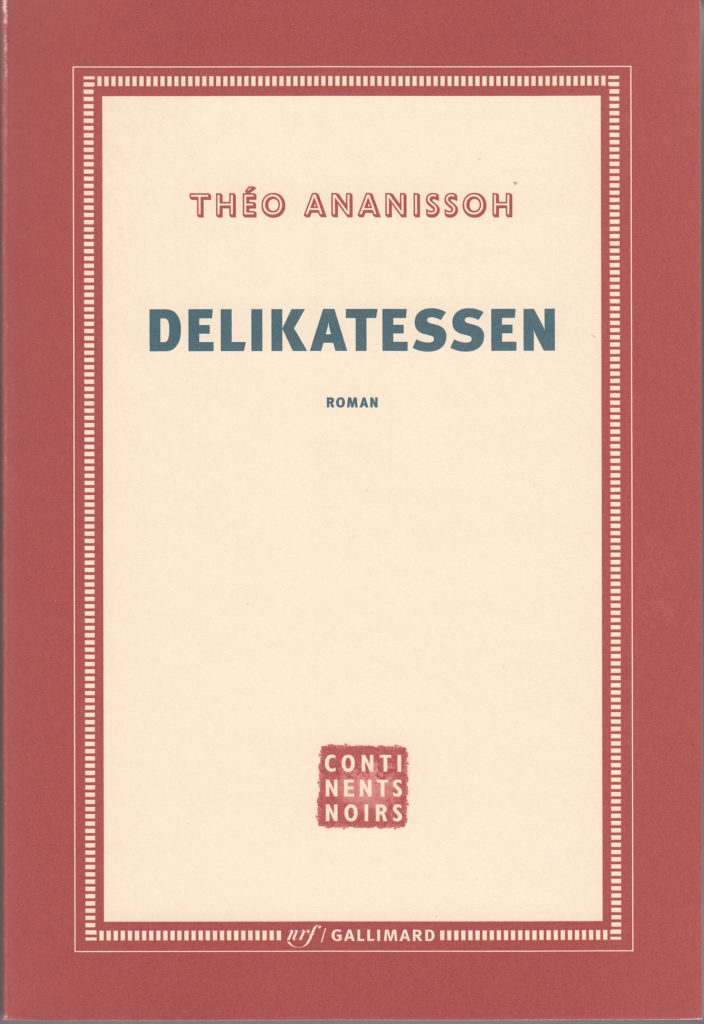
BL : La femme et le sexe occupent une place non négligeable dans vos livres. Il y a certainement une raison à cela?
TA : La sensualité, oui. D’autres sujets aussi m’obsèdent, si j’ose dire : le paysage, l’exil, le retour chez soi, le devoir de mémoire, celui de punir quiconque humilie ou détruit capricieusement son prochain, ainsi de suite.
BL : Alain Mabanckou a dit que la fin des dictatures africaines est proche, mais, à l’allure où vont les choses, rien qu’à considérer ce qui se passe actuellement au Congo et au Togo, n’est-on pas en mesure de croire que ces dictatures ont encore de beaux jours devant elles puisque la communauté internationale et les puissants de ce monde ne font rien pour les décourager; surtout que Alain Mabanckou soutient (et les faits semblent lui donner raison) que les pays où sévit le plus la dictature sur le continent, sont ceux qui ont en commun la francophonie?
TA : Je ne suis pas prophète. Je pense que la liberté, la défense de la liberté individuelle et collective est une tâche permanente, jamais finie. La tyrannie peut se métamorphoser, prendre des formes déguisées et perverses.
BL : Denis Mukwenge, dans son discours, à l’occasion de la réception du Prix Nobel de la Paix, en partant de son Congo natal, a présenté un tableau très sombre de l’Afrique. Vous, écrivain et prophète, pensez-vous que tant que les terres et les sous-sols africains seront au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques (or, pétrole, cobalt, phosphate, bois, ivoire), nous aurons la prospérité et la paix véritable sur le continent noir?
TA : La tâche pour les peuples africains plus que jamais est celle de produire une volonté nationale afin de pouvoir défendre leur existence et leurs biens contre toute agression extérieure. Cette question fait ou impose la nature du régime politique approprié. Raisonnons comme ceci : si par extraordinaire, vous tuez demain matin Madame Angela Merkel, vous ne tuez pas la volonté nationale allemande. Vous ne changez absolument rien au cours des choses en Allemagne. Cela n’a pas toujours été ainsi. En 1942 ou 43, si vous tuiez Hitler, vous changiez tout, vous mettiez fin à un régime politique (extrêmement criminel). Bien, passons à un pays d’Afrique comme la RD Congo. Le sous-sol est « trop » riche, les enjeux et les appétits prédateurs sont trop irrépressibles pour qu’un système présidentialiste tel qu’on le voit partout en Afrique tienne le coup face aux violences et aux ruses méchantes de toutes sortes. Il faut faire comme les Chinois : diriger en groupe ; inventer un leadership politique collégial. De sorte qu’on ne puisse pas torpiller aisément l’affirmation de la volonté nationale en assassinant un seul homme. Obama a dit quelque chose d’approchant aux Africains en leur conseillant de créer des institutions fortes qui s’imposent à tous. C’est ça ou la mort. Au Togo, en janvier 1963, il a suffi de tuer Sylvanus Olympio. La débandade a été immédiate et totale. Ceux qui l’entouraient se sont éparpillés, ont été traqués, chassés ou achetés. Plus rien n’est resté du leadership nationaliste qui avait arraché l’indépendance. (Le colonisateur s’est conduit exactement comme quelqu’un qui, ayant perdu lors d’un match, a ensuite tendu un guet-apens meurtrier à son adversaire hors du stade.) Sous nos yeux, en Côte d’Ivoire, il a suffi de pilonner Gbagbo. Kaddafi en Libye. De même en ce moment au Venezuela. Le présidentialisme africain actuel, c’est se livrer en cible parfaite aux ennemis sur un terrain vague. Il y a en Afrique beaucoup de ce que j’appellerais des présidents théoriques ou en théorie.
Je reconnais que l’accomplissement de ce que je dis est extrêmement difficile. Il faut de l’éducation ; pour cela, il faut permettre à cette catégorie particulière de citoyens que sont les producteurs d’œuvres de l’esprit, écrivains et intellectuels de toutes sortes, de prévaloir dans l’espace public et dans les écoles afin d’éduquer à l’éthique. Mais je n’ignore pas non plus que les écrivains et intellectuels eux-mêmes souvent sont lâches et opportunistes étant donné leur profond et légitime besoin de reconnaissance. Donc ? Eh bien, je ne sais pas ! Je suppose qu’à force de subir, nous finirons bien par apprendre à avoir les comportements justes.
BL : La situation actuelle dans votre « Centrafrique natale » est très dégradée. Et ce pays qui vous a vu naître est aujourd’hui aux mains de deux puissants qui font hisser sur son sol leurs drapeaux : France et Russie, deux Etats qui détiennent le droit de veto à l’ONU et passent aussi pour maîtres dans le trafic et la vente des armes. On arme le pays pour que ses fils s’entre-tuent. Qu’est-ce que tout cela vous inspire?
TA : Situation très compliquée et désastreuse, oui. Je m’y intéresse beaucoup. Quand je pense à la Centrafrique, je suis triste, quasiment malheureux. Depuis de nombreuses années, je souhaite y retourner pour un travail littéraire sur mon enfance. Je dois à la RCA, à ce pays intense où j’ai été un enfant heureux, un ouvrage littéraire. L’adulte africain que je suis devenu est porté par les années que j’ai passées dans ce pays au cœur de notre continent. La présence russe me semble stratégiquement et historiquement une bonne chose. C’est un choix politique judicieux et très courageux qu’a fait le président Faustin Touadéra, à mon avis.
BL : Ne pensez-vous pas qu’il serait mieux -finalement- que les pays africains renoncent à la démocratie et qu’on revienne à la royauté, ainsi nul ne sera plus heurté par ces successions de père en fils qui ont encore cours chez nous, spécialement au Togo?
TA : Non ! On ne revient à rien. On avance en inventant le chemin et la situation qu’il faut. Imagination et volonté, toujours.
BL : Monsieur Théo Ananissoh, nous tendons vers la fin de notre interview. Quels sont les chantiers littéraires et/ou culturels sur lesquels vous travaillez actuellement ?
TA : Après la parution de Delikatessen en octobre 2017, j’ai souhaité revenir pour un trimestre au moins chez moi au Togo. M’y promener, me ressourcer. Je l’ai fait. Quatre fois pendant ce séjour, j’ai sillonné la côte du Togo et du Bénin. J’ai visité et revu les lieux. J’ai fait des interviews avec des gens plus jeunes que moi. Un an auparavant, en mars 2017, j’ai fait en voiture le trajet de Lomé jusqu’à la frontière du Burkina. J’avais souvent fait ce trajet autrefois, quand j’étais au lycée à Dapaong, tout près du Burkina. A plus de cinquante ans, et après une trentaine d’années d’exil en Europe, il me fallait me réapproprier mes lieux et mes paysages. Afin de continuer d’être un écrivain comme je le souhaite. J’ai des projets d’ordre culturel au Togo dont je préfère parler plus tard quand ils seront plus avancés.
BL : Votre mot de la fin, Monsieur Théo Ananissoh.
TA : Ça me fait plaisir que vous ayez lu mes romans. Parce que vous êtes un Africain jeune.



