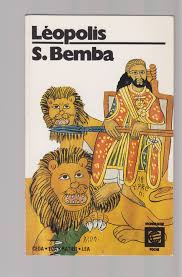
« Cinquante ans de musique au Congo-Zaïre ». C’est par ce livre que le nom de Sylvain Bemba s’est incrusté dans mon esprit. Le volume de couleur sombre, sur lequel apparaissait le visage de Tabu Ley, trônait à un endroit de la bibliothèque dont je me souviens comme si c’était hier. Je l’aurais lu à coup sûr si l’ouragan des passions n’était passé par là. Ma fièvre pour la rumba congolaise, que je nomme musique du fleuve, m’y aurait enjoint. Le nom par lequel cet homme pudique dissimulé par une armée de pseudonymes s’était déjà imposé en Afrique et ailleurs au temps des bizarreries d’un gamin qui contemplait les livres. Il jouissait encore d’une renommée considérable en cette heureuse après-midi où je fus frappé par son arrivée chez nous. C’était, je l’ignorais, mon unique rencontre avec l’immense artiste. J’avais quatorze ans. Le nimbe de son prestige, sa moustache patricienne, sa calvitie consulaire, la solennité de son maintien, ses lunettes austères, en sorte le nécessaire pour m’intimider, singularisaient au contraire un homme avenant. Contre cet âge qui éloigne les poulains remuants de la compagnie des adultes, je m’intéressai à lui. Mon père, pour une fois, ne borna pas ma curiosité par ces injonctions muettes dont les parents possèdent la science. Son illustre hôte et moi parlâmes d’une chose et d’une autre. Si cette rencontre avait suffi pour me lier à lui au point qu’une vive émotion recouvre encore la moindre évocation de sa personne, la caisse de livres qu’il m’envoya dans la foulée de notre échange me transforma en admirateur zélé. Je n’ai malheureusement pu lui exprimer ma gratitude, la nouvelle de son décès à Paris me renversa quelques mois seulement après ce précieux présent. Les « pourquoi », les conjectures incapables de recommencer l’histoire, les regrets, m’envahirent. Le sort, souveraine brutalité, me rudoyait. Il m’empêchait surtout de payer cet oncle de sa générosité. Ce qui alors me parut une injustice changea de signification plus tard. Par ce geste cette noble âme exprimait, je crois, la demande tacite de servir toujours ce qu’il aima le plus. Dans la caisse gisait Tarentelle noire, diable blanc. Notre cheminent commençait. Depuis lui ont succédé, Un monde trop foutu pour un blanchisseur trop honnête et Léopolis.
Lumumba lynché, pensaient ses bourreaux, disparaîtrait sous des strates d’oubli. Usuraires de l’outrage et du déshonneur, ils lui refusèrent jusqu’au sein hospitalier de la terre. Pas de sépulture pour les ennemis de l’impérialisme, pas de dévotion posthume pour un traitre. Certes le Polynice équatorial ne fit pas se lever Antigone, mais son sang mouillait encore la jungle katangaise qu’il devenait un martyr. Son exécution indigna le monde entier. Parce que l’idée de liberté leur est consubstantielle, les artistes, dans un double mouvement, condamnèrent le crime et célébrèrent le héros occis. Aimé Césaire lui consacra sa pièce Une saison au Congo, Sylvain Bemba lui emboita le pas, faisant l’honneur à son aîné de ne pas l’émuler avec une autre pièce. Il conçut un roman. Raoul Peck lui consacra deux films. Malgré les précautions de ses assassins leur vœu infâme ne se réalisa pas, Emery Patrice Lumumba réémergea, son souvenir s’éternisa dans les mémoires. Le romanesque somptueux de Léopolis en peint légende.
Captivée par le mythe de Léopolis, l’ancienne capitale du Wallabi désormais ensevelie sous la forêt, la chercheuse américaine Nora se lance, accompagnée de Mujima un universitaire wallabian, à la quête du site de la cité disparue où vécut Fabrice Mfum le leader assassiné de l’indépendance de ce pays imaginaire, avatar fictionnel de Lumumba. Perdus dans l’immense forêt, Nora Norton et Mujima y séjourneront quelques jours. Mystère de la forêt ou hallucination, la tragédie de l’éphémère Premier Ministre wallabian se projette dans les rêves de Nora Norton. Dramaturge, il eût été naturel qu’un sujet de cette dimension s’épanouisse dans une pièce. Un poème l’aurait également magnifié, mais Sylvain Bemba s’il était poète, ne forgeait pas de vers. Le choix du roman relève donc, risquons l’hypothèse, du défi artistique. Ce genre n’étant pas l’idéal pour l’expression du mythe, Léopolis signe le succès d’une audace. La vie et le pouvoir de Lumumba, secondaires quant à son projet, sont le châssis sur lequel Bemba a superposé l’invraisemblable nécessaire à la présence du fabuleux. Si la déception attend de pied ferme les passionnés d’histoire qui s’égarent dans la fiction en vue d’y trouver la rigueur et la prudence de cette science, l’amateur de littérature s’émerveillera en revanche, outre la langue racée et musicale de l’auteur, de ses audaces, de son humour. Bien entendu, la motivation de l’ouvrage résidait non dans l’examen d’une figure historique, mais dans l’hommage artistique. L’art ne concurrence pas la science quant à l’explication du réel, cependant il possède sur lui l’avantage de la liberté représentative. Ses figures, idéalisées dans ses divers genres, se hissent sur la voute étoilée où, comme les galaxies, elles guident la navigation des peuples et des individus. Fabrice Mfum en est conscient : «on dit que la science est née à partir où les hommes apprirent à se guider sur les étoiles. Chez nous, la conscience sera guidée par les yeux éveillés des martyrs de notre indépendance». Ôtant à la langue les scories du parler ordinaire, Sylvain Bemba la sublime, réalisant son dessein par un mélange de tragique et de réalisme merveilleux. Enrichissant ce roman court, le complexifiant sans l’obscurcir, l’intrigue enchâssée, la multiplicité des voix, les sous-thématiques (l’élite africaine oublieuse de ses traditions, le sexe comme arme politique, par exemple), les pépites de culture disséminées par l’artiste congolais, composent un objet littéraire de grande étoffe.
La transfiguration de Lumumba en figure légendaire précède de loin la publication de Léopolis. Sylvain Bemba, y associant une dose d’imaginaire, ne fait que lui façonner un corps littéraire. L’analogie de Fabrice Mpfum avec le Christ abhorré, humilié et supplicié en constitue l’aspect dominant. Les partisans de l’ordre ancien, ulcérés par l’indépendance du pays et le libre esprit de Mpfum le veulent mort : « Il a beau rugir, il mourra misérablement comme un chien ». A l’instar du Jésus de l’Evangile, Mpfum, animé par une sorte de prémonition, envisage sa disparition, avec courage : « ils ne me font pas peur, même si je reste seul contre tous. Je lutterai jusqu’au bout et je mourrai en les regardant en face. Mes yeux seront des étoiles qui, même invisibles la journée, brilleront d’un vif éclat dans le ciel endeuillé de Léopolis. » La postérité lui donnera raison, il le sait. « On ne comprendra le sens de mon combat qu’après ma mort, dit-il, peut-être comme cela s’est passé pour les idées de Jésus de Nazareth. » Il ne croyait pas si bien dire, ne jouit-il pas après sa mort de la vénération dévolue aux saints ? Le talisman contre lequel il sacrifice de sa mère et écourte sa vie dans l’espoir d’une gloire éternelle fait penser à l’Achéen Achille et à Raphaël de Valentin de La peau de chagrin. « Tu auras tout, mais tu devras sacrifier tes plus chères affections ».Il évoque surtout, dans le contexte africain, l’occultisme qui entoure le pouvoir.
Léopolis c’est aussi le roman d’une décolonisation et d’une démocratie escamotées. Gêneur, trouble-fête, Mfum-Lumumba voulait, contre les ambitions néocoloniales, une liberté de plein exercice. « Les tractations à l’Africaine » qui aujourd’hui encore hissent au pouvoir des « usurpateurs »bénéficiant de « soutiens extérieurs » ne lui convenaient guère. C’était là son crime. « Après les indépendances, tous nous avons parlé de chasse pour ramener la dépouille de l’éléphant. Certains s’imaginent qu’il suffit de s’allonger sur la chaise longue, et de souhaiter la mort du colonialisme, c’est à-dire de l’éléphant, pour que cela se produise réellement. A moi on ne pardonne pas d’aller en forêt et de chercher à tuer avec de vraies balles les bêtes qui viennent ravager nos plantations encore fragiles». Comme les pharisiens avec le Nazaréen, comme les démocrates d’Athènes avec Socrate, le colonisateur n’entendait pas laisser faire celui qu’ils nommèrent le « grand fumiste ».
Dans le moment de grande tension où Sylvain Bemba écrivit cette œuvre (1984), Lumumba s’imposa comme celui qui, par la folie du courage, l’ivresse patriotique, et l’inaltérable probité aiderait les Africains à affronter les grands chambardements annoncés dans le mouvement à peine perceptible de l’histoire. 60 ans après les indépendances, le cœur alourdi par la tristesse du passé et par l’incertitude de l’avenir, la méditation de l’épitaphe symbolique qu’est Léopolis est encore de mise : «Il vaut mieux être un chien vivant qu’un lion mort“ ; est-ce le pari que veut faire l’Afrique indépendante ?»
Philippe N. Ngalla

Philippe N. Ngalla



