« Tous nos noms » de Dinaw Mengestu : lecture de l’enfumage onomastique comme clé de voûte d’une construction identitaire.
Dinaw Mengestu est un écrivain de nationalité américaine, d’origine éthiopienne. Il est né à Addis-Abeba en 1978, pendant la crise politique qui secouait l’Éthiopie à cette époque. Laquelle crise va pousser sa famille et lui à s’exiler aux USA, deux ans après sa naissance. Mengestu va donc grandir dans le manque-absence de sa terre natale à laquelle il a été brusquement arraché, et le désir de s’intégrer dans une Amérique elle-même déchirée par des revendications et des luttes pour les droits civiques. La nostalgie du bercail et l’obligation de s’intégrer dans ce pays qui valse au rythme des inégalités raciales, vont le confiner dans une sorte d’entre-deux-identitaire. Cette vie à cheval entre deux cultures – la culture africaine dans laquelle il vit en imagination et la culture de sa terre d’accueil– va le pousser à se mettre à l’écriture afin de mieux questionner sa situation et de prendre conscience de son identité non moins complexe qu’il n’entend réduire ni à son Ethiopie natale, ni à l’Amérique qui l’a adopté, ni à sa race noire. L’écriture va ainsi lui permettre de construire et/ou de reconstruire son identité qu’il entend affranchir des frontières culturelles, géographiques et raciales : « j’ai commencé à sentir que je n’étais pas seulement Éthiopien, pas seulement Noir ou pas seulement Américain. J’ai beaucoup lu pour essayer de comprendre l’histoire de la famille, et l’écriture a été une manière de me construire et de trouver ma place. »(Entretien de Nicolas Michel avec Dinaw Mengestu, Jeune Afrique économique, Août 2015.)
De ce fait, l’œuvre romanesque de Dinaw Mengestu est un terreau de réminiscences. Elle porte les stigmates de son passé douloureux et rend compte de la complexité qu’il y a à vivre loin de son bercail terrestre. Son écriture est fortement marquée par le thème de l’immigration et l’évocation des questions identitaires. Ses romans laissent généralement explorer une géographie intime entre l’Afrique et l’Amérique. Ils tracent le plus souvent l’itinéraire d’un immigré africain qui s’exile pour les USA, à cause de la guerre qui sévit dans son pays. Dans son troisième roman, Tous nos noms(Albin Michel, 2015) – après Belles choses que porte le ciel et Ce qu’on peut lire dans l’air publiés respectivement en 2007 et en 2011 chez Albin Michel –il nous fait justement part de l’histoire d’un Éthiopien de 25 ans qui quitte son pays natal pour la capitale ougandaise, sous prétexte de poursuivre ses études dans la grande Université qui s’y trouve. Et très vite, sur une venelle du campus universitaire de Kampala, il va rencontrer Isaac, un jeune ougandais, qui deviendra son meilleur ami. C’est d’ailleurs Isaac, révolutionnaire jusqu’à l’âme, qui l’enrôlera dans la révolution estudiantine contre la misère d’une partie de la population et ensuite dans la crise socio-politique qui va éclater dans ce pays africain. Vu l’ampleur des affres de cette crise, le narrateur va s’enfuir pour les USA où, une Américaine de race blanche s’éprendra d’amour pour lui. Cette idylle entre le narrateur et son assistante sociale, Helen, dans un environnement extrêmement raciste, va d’une certaine manière briser le tabou de l’impossibilité et de la désapprobation de l’amour hybride, entre Blancs et Noirs ; jusqu’à ce que les deux se séparent sur une rue de Chicago, où l’Éthiopien prendra une direction inconnue en lui promettant de revenir.
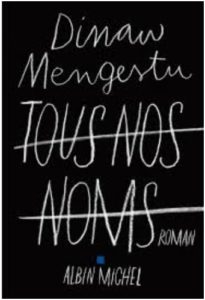
En effet, l’un des plus grands plaisirs qu’on prend à lire ce roman, se tisse autour de ce que j’appelle « l’enfumage onomastique », qui rend compte du jeu onomastique des personnages. Mengestu jette un flou sur les noms de ses personnages, au point de confondre certains, pour peu qu’on soit moins attentif. D’une part, il cache le véritable nom de son protagoniste. D’autre part, il lui fait porter le nom de son meilleur ami lorsqu’il s’exile en Amérique. En fait, tout commence en Afrique, lorsque le narrateur quitte son Ethiopie natale. Aussitôt que le véhicule qui le transporte franchit la frontière ougandaise, il va se débarrasser des noms que lui avaient donnés ses parents :«Dans le bus qui m’emmenait à la capitale, je décidai de renoncer à tous les noms que mes parents m’avaient donnés. J’avais presque vingt-cinq ans, mais j’étais bien plus jeune que ça à tous points de vue. Je me défis de ces noms quand notre véhicule franchit la frontière de l’Ouganda. On approchait du lac Victoria ; je savais que Kampala était proche, mais j’avais déjà décidé d’y penser uniquement comme étant « la capitale ». Kampala était trop étriqué pour ce que j’imaginais. Si la ville faisait bien partie de l’Ouganda, la capitale, tant qu’elle n’avait pas de nom, n’avait aucune allégeance. Comme moi, elle n’appartenait à personne et nul ne pouvait la revendiquer. » (p. 12)
Par ailleurs, tout au long du roman, le narrateur-protagoniste nous cache son vrai nom et nous donne pour seule indication : « D… », qui est en réalité l’initiale du nom que lui avait donné son père à sa naissance. « D… » comme « Dinaw » ? On n’en sait rien ! Il faut dire que nulle part dans le texte, sa réelle identité onomastique n’est dévoilée et on ne se contente donc que de quelques surnoms que vont lui attribuer Isaac (Professeur, Langston le poète, Ali ; parce qu’il a les allures d’un professeur et il rêve de devenir écrivain) et Helen (Dickens ; parce qu’elle estimait qu’il parlait comme un personnage de Charles Dickens). Le nom « Isaac » qu’il va porter dès son arrivée aux USA, est celui de son meilleur ami qui refuse de quitter son pays (l’Ouganda) malgré la crise socio-politique qui bat son plein et lui permet de voyager en lui donnant son passeport : « A Nairobi, j’ai ouvert le carnet de notes qu’Isaac m’avait remis. Il contenait exactement ce qu’il m’avait promis : une liste de tout ce que j’avais besoin de savoir avant d’arriver en Amérique, du visa à l’ambassade jusqu’à la compagnie d’aviation et aux informations pour retrouver Henry une fois sur place. Les pages du milieu étaient noircies de notes qui m’étaient destinées. Sur l’une des pages il avait recopié sa liste des crimes contre la nation […] Sur une autre, la liste des noms qu’il m’avait donnés : Professeur, Langston, Ali, qui terminait par celui qui figurait sur le passeport, Isaac Mabira, notre nom à tous les deux aujourd’hui. » (p. 314)
Au prisme de tous ces éléments, l’immigré présente essentiellement deux figures identitaires sous l’œil de Dinaw Mengestu. On peut parler d’une part de sa capacité à vivre comme un caméléon, et d’autre part de sa propension à vivre comme un oiseau. Il se conçoit comme un homme caméléonesque en ce sens qu’il réussit à s’adapter, à s’ajuster également, aux différentes réalités socio-culturelles que lui imposent ses espaces d’adoption. Et cette intégration passe notamment par le changement de nom ainsi que l’adoption de plusieurs autres qui correspondent à son nouveau milieu de vie. Langston le poète est donc aussi un homme-oiseau, parce qu’il vit « son identité comme une configuration à la géométrie variable, pourvue de repères peu stables qu’il active successivement selon le contexte, en se démarquant de toute allégeance politique, nationale ou culturelle liée à sa communauté d’origine. »[1] Son identité est à l’image de la vie et des mouvements d’un oiseau qui survole le ciel, sans cesse, au-dessus de tous, et dont le déploiement ne connaît aucune limite géographique. Langston le poète ne fait aucune fixité spatiale et son identité survole les frontières étatiques et continentales. C’est ce qui ressort de cette confidence faite à Helen, sa petite amie, qui est curieuse de savoir plus sur ses origines qu’il ne cesse de lui dissimuler : « « Le jour de mon départ [du village], il [mon père] m’a longuement serré dans ses bras. Quand j’étais petit, il m’appelait l’Oiseau. Il disait que mon royaume c’était le ciel, tout là-haut, au-dessus de tout le monde. Tu reviendras, m’a-t-il glissé à l’oreille. […] Bien sûr, ai-je répondu. J’ai cru qu’il allait me faire promettre d’écrire. Mais il s’est contenté de m’embrasser quatre fois – deux baisers sur chaque joue. Non, l’Oiseau, je sais que tu ne reviendras pas, a-t-il murmuré. […] « Je suis allé à Addis-Abeba, j’ai pris une dizaine de cars différents pour atteindre le Kenya, puis l’Ouganda. En arrivant à Kampala, je n’étais plus personne ; c’était exactement ce que je voulais. » » (pp. 226-227)

L’enfumage onomastique– avec le fait du nom inavoué, le changement de noms à chaque fois que l’immigré passe d’un espace à un autre et l’acquisition des surnoms– est donc à l’image de l’identité du protagoniste. Le protagoniste de Mengestu est d’une identité transfrontalière et transversale qui s’affranchit des limites spatiales. C’est une identité qui se moule par-dessus les frontières de sa terre originelle et n’est rattachable à aucun espace géographique précis ; si oui, elle est imputable à tous les espaces que l’immigré visite concrètement ou en imagination. Langston le professeur poète qui ne s’attache véritablement à aucun espace, même pas sa terre natale, encore moins à ces terres qui l’accueillent, se pose en même temps comme un homme de partout et de nulle part ; d’autant plus qu’il s’arrange à chaque fois à s’acculturer. Décider de ne pas avoir de nom ou de le cacher en adoptant des surnoms lorsqu’on change de pays ou de continent, est une manière de dissimuler ses origines dans l’optique d’être considéré exclusivement comme un Homme et partant, comme un Citoyen du monde. C’est ce qui explique le titre barré de l’œuvre : Tous nos noms, qui renseigne que l’espace peut être universel, appartenir à tous, au même titre, sans distinction entre l’autochtone et l’étranger ; dans la mesure où on n’a pas de nom. Etant donné que le nom est le premier élément d’identification susceptible de trahir les origines de l’être humain, il faut le cacher (synonyme de ne pas l’avoir) pour se mettre à l’abri de la stigmatisation, de l’ostracisme et de la xénophobie.
Boris Noah

Université de Yaoundé I
boris.noah52@gmail.com
[1]Christiane Albert, L’Immigration dans le roman francophone contemporain, Paris, Karthala, 2005, p. 124.