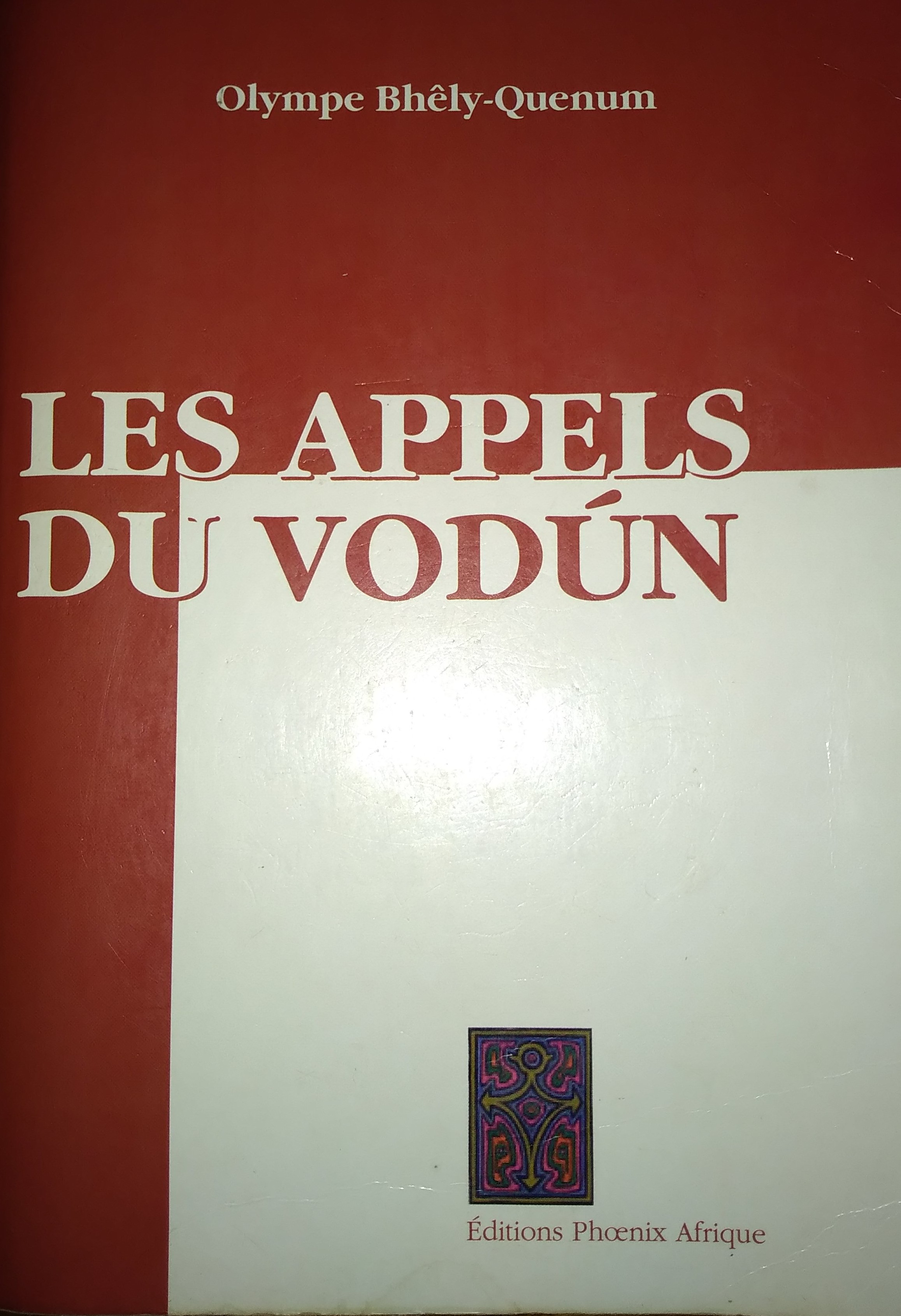INTRODUCTION
Olympe Bhêly-Quenum est un écrivain que l’on ne présente plus. De par ses écrits, de par son style et sa thématique, il a toujours montré son attachement à sa terre, à ses origines, à sa culture.
De nature jaloux de son héritage culturel tel un digne descendant de Vodúnsi, Olympe Bhêly-Quenum commence à sourire à la vie un 20 Septembre 1928 à Ouidah, ville coloniale, et en même temps creuset du Vodún ; une telle situation spatio-temporelle de ses origines n’ayant pas manqué d’influencer son style littéraire et ses prises de position. Né avant les indépendances en Afrique et ayant vécu l’époque coloniale, il a toujours su user de ces atouts non négligeables pour défendre sa culture, ses origines, et faire une guerre pacifique tant au colonialisme qu’au néocolonialisme puis aux différents maux qui minent la terre noire. Ainsi, comme nous ne manquons pas de le mentionner ici sur Biscottes Littéraires, dans ses œuvres que ce soit « Un piège sans fin », « C’était à Tigony », « L’initié », « Un enfant d’Afrique », « La Naissance d’Abikou », et cette fois « Les appels du Vodún » dont c’est le tour pour être présentée, et j’en passe, il faut s’attendre à le voir dézinguer les idéologies colonialistes et dénoncer vivement les mauvais us de ses frères Noirs. Une objectivité qui n’a de cesse à raviver l’originalité de ses écrits dont les protagonistes sont toujours des personnages originaux.
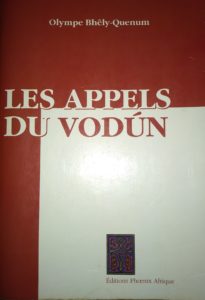
De l’œuvre
Comme toujours, un titre qui, aussi simple se présente-t-il, génère un vivier de réflexions : « Les appels du Vodún » !
Bien-sûr que d’aucuns voudraient savoir comment le Vodún appelle ; mieux, qui appelle-t-il, et qui est digne d’être appelé. Mais le Vodún parle-t-il ? Comment est-il ?
En effet, constituée en soixante-trois (63) chapitres, et le tout formant 514 pages, l’œuvre parut sous une nouvelle édition corrigée et remaniée par l’auteur en 2007, aux éditons Phoenix Afrique, après avoir fait objet d’une première parution aux éditions Harmattan, Paris, en 1994.
Bien qu’écrite dans un contexte post colonial, période où la majorité des plumes, qu’elles fussent anglophones, francophones, lusophones etc., avait pour priorité thématique les tares de l’impérialisme colonial transmises au néocolonialisme d’une part, et les maux, que ne furent coup d’Etat, chômage, débauches sexuelles, pauvreté, insécurité etc., dont ne cesse de souffrir l’Afrique d’autre part, l’œuvre se soumettant à l’esprit innovateur et l’originalité de son auteur, se voit consacrée à la vie socio-culturelle africaine à travers le culte Vodún, identité indéniable du Continent Noir en général, et du Bénin en particulier. Une autre particularité : cette fois, ce ne sont pas seulement les lieux qui soient proches du réel ; les personnages également échappent de loin à l’imaginaire.

L’histoire se déroule à Gléxwé (Ouidah), à 40km de Koutonou (Cotonou) où venait de rendre l’âme une Grande Prêtresse vodún. La nouvelle n’y étant pas encore répandue, Vicédessin est aperçue de loin par Toinou, un proche qui entreprend de se rapprocher pour la saluer comme le lui intime son éducation. Grand-Maman était en compagnie de Yaga, Tánnyì Bonin, et Akpôtô, morts trois décennies plus tôt que Toinou ne sut reconnaître. Tous en discussion, ils entrent dans Azizonsa, la demeure ancestrale. Engagé sur leur pas, le jeune arrive dans la maison où il découvre consternation : on pleurait la mort de la septuagénaire. Qui avait-il donc aperçu tout à l’heure ? Avait-il rêvé en plein jour sur sa moto ? Pas possible ! Ce ne put être un rêve ni ensommeillé ni éveillé. Même s’il finit par réaliser la certitude de sa mort, Toinou reste convaincu d’une autre certitude : il avait bien vu et reconnu Grand-Maman, qui n’a pas tardé à faire signe à Agblo Tchikôton, son fils, demeurant à Paris (France). Dans la tête de ce dernier, a commencé par résonner la voix de sa mère fredonnant des hymnes vodún dont avait été décorée son enfance. Du coup, une envie : réécouter la fameuse cassette sur laquelle il avait fini par enregistrer la majeure partie des chants vodún que sa mère lui chantait. Mais le téléphone sonne. Il décroche et apprend la nouvelle qui était loin d’abattre l’homme courageux qu’il est : Mémé est morte. Non, Mémé a rejoint les ancêtres. Certes, le lien qui lie Aglo à sa mère est si fort qu’il ne peut pas ne pas souffrir de son absence, mais sa foi et son attachement à sa culture, à la tradition le confortent de ce qu’elle est toujours là présente à ses côtés. Il était juste temps qu’elle rejoigne la « Cour des anciens ».
L’œuvre, tout en prenant le soin de braquer le projecteur sur la vie de Vicédessin depuis son chevauchement et sa possession par le Vodún (alors qu’elle n’avait que 10 ans) jusqu’à sa mort, se consacre à décrire dans les moindre détails la cérémonie de l’inhumation de cette Prêtresse vodún déroulée en quatre jours et à laquelle participe activement Agblo Tchikôton, son fils, chrétien, intellectuel de son état, et par surcroît non initié vodún. Chaque acte, chaque chanson, chaque rituel, chaque geste, bref chaque étape comme prescrite par le culte Vodún y est respectée et décrite.

Des personnages
Des multiples personnages ayant donné vie à cette belle histoire, ceux-ci se révèlent les plus remarquables :
Vicédessin : Grande Prêtresse vodún, septuagénaire, elle est l’héroïne de l’histoire. Chevauchée et possédée par le Vodún dès son jeune âge, elle s’y consacre en bonne initiée. Ayant assuré une bonne éducation à ses enfants, elle se réserve d’influencer leurs orientations religieuses quand bien même elle leur inculque l’attachement à leur culture, leur tradition. Elle est l’image d’une vraie femme africaine qui sait être une épouse idéale, une bonne mère, une bonne grand-mère, et une vraie femme d’affaire dont les activités sont loin d’être perturbées par son état de Vodúnsi, de Coryphée et de Prêtresse. Elle meurt à 78 ans et est accueillie par les anciens dans la demeure ancestrale. Quelle Africaine, jalouse de ses origines, n’aurait pas aimé avoir une telle vie !?
Tánnyì Bonin : Tante de Vicédessin, elle fait partie de ceux qui viennent accueillir cette dernière dans le dernier lieu de repos. Sœur Yaga, elle a joué un très grand rôle dans l’éducation non seulement de sa nièce, mais aussi des enfants de cette dernière. Très affective, elle a toujours été un repère, un exemple pour Vicédessin, ainsi que pour nombre d’enfants qui l’admirent beaucoup pour son côté à la fois maternel, affectif et ferme.
Yaga : Sœur de Bonin, et mère de Vicédessin, elle a été une mère parfaite pour ses enfants. Bien qu’étrangère, puisque d’origine Yoruba, elle n’a pas démérité dans l’éducation qu’il lui revenait de donner à ses enfants, notamment Vicédessin qui a été choisie par le Vodún. Epouse soumise à son mari, qui l’avait enlevée à sa famille lors d’une bataille et dont elle finit par être éprise, elle a constitué un modèle pour tout son entourage tant dans sa rigueur que dans sa chaleur maternelle. Elle va, avec sa sœur et son fils, accueillir Vicédessin après le décès de celle-ci.
Akpôtô : Frère de Vicédessin, il aimait beaucoup sa sœur. Très proche de son père Atakpa, il assiste souvent ce dernier et apprend beaucoup de lui comme le veut son éducation. Il a toujours su jouer son rôle de fils, de frère, d’oncle etc. Il a presque toujours été présent quand on a besoin de lui. Après la mort de Vicédessin, il ne manque pas au rendez-vous pour l’accueillir au dernier demeure.
Daágbo : Epoux de Vicédessin, père de Agblo Tchikôton. « Stature élancée, muscles longs et fermes, teint d’un brun mat, front larges et intelligent, menton volontaire dans un visage long encadré par un collier de barbe rase poivre et sel comme la moustache, Daágbo avait les traits fins, les yeux d’un marron un peu clair, legs génétique perceptible chez la plupart de ses cent cinquante enfants. Sa présence créait dans la villégiature un climat de détente… » (P. 61). Ce sont là les meilleurs mots qui le décrivent. L’on n’en saurait dire mieux. Imposant tant dans sa carrure que dans ses élans, Daágbo est fier de ses origines et, bien qu’ayant été à l’école des Blancs, reste attaché à sa tradition, sa culture. Ceci, il le transmet en héritage à sa descendance avant de mourir dix-sept ans plus tôt. Il représente dans l’œuvre l’une des belles images que l’auteur veut pour l’Africain.
Agblo Tchikôton : L’enfant prodige. « Quinquagénaire de taille élancée, d’allure impassible, au visage ovale, à l’air froid et apparemment distant qu’était son grand-père. » (P. 35) Digne fils de ses origines, il naît dans un milieu, creuset du culte Vodún, identité culturelle de l’Afrique, milieu du Bénin. Ce même milieu, ancienne capitale du commerce d’esclaves noirs, devenu fief des quelques reliques d’Occidentaux qui y ont établi demeure. Dans ce Gléxwé où se côtoient Vodún et Christianisme, le jeune Agblo grandit et va à l’école des Blancs, particulièrement à l’école des Catholiques. Fils de Vodúnsi, il se voit initié à la foi catholique. Avec le temps, il va en Europe pour ses études et y finit par établir demeure. Il se marie à Georgette, une Blanche. Sa vie paraît comme un contraste puisque remplie de contraires. L’on aurait juré qu’il est la source d’inspiration de la philosophie d’Héraclite s’ils avaient été de la même époque. Toutefois, cette hybridité de sa vie ne le détourne point de son attachement à ses origines. Il est loin d’être déraciné, de même que ses enfants à qui il transmet cet attachement à l’Afrique. Et puis, vu d’une autre manière, ne serait-il pas Olympe Bhêly-Quenum lui-même ? se demanderait-on.
Gbeyimi : Sœur de Agblo, elle est la fille aînée de Vicédessin. Elle a reçu la même éducation que son petit frère, des mêmes parents, dans le même contexte. Sa mère aurait aimé qu’elle lui succède dans son activité de commerce. Mais elle y a lamentablement échoué ; une confirmation que tout ne saurait être parfait dans une famille. Toutefois, elle ne mènera pas une vie moins reluisante. Ensemble avec son frère, elle remplira son devoir dans l’organisation et le déroulement de l’inhumation de leur mère.
Toinou : Un jeune de 25 ans, proche de la famille Xwénu. Du retour de la messe du dimanche, il aperçut de loin Grand-Maman qu’il entreprit de saluer, de peur de s’en vouloir de ne pas l’avoir comme on le lui a appris. Il sera surpris à son arrivée dans la maison des Xwénu de voir que tous pleuraient celle qu’il venait d’apercevoir, celle-là dont il vient de suivre en venant là. Mécréant, il va jusqu’à Koutonou pour s’enquérir de la véracité de ce qui lui paraît jusque-là une absurdité. Il finit par accepter la réalité. Il avait certes vu Grand-Maman, mais celle-ci avait rendu l’âme plus tôt. Sa présence dans l’œuvre est le moyen pour l’auteur de démontrer en quoi cette idée qu’« en Afrique, on peut voir quelqu’un qui est décédé tantôt et dont on en sait encore rien » ne serait pas une superstition, une fausse histoire.
Georgette : Epouse de Agblo Tchikôton, belle-fille blanche de Vicédessin. Elle soutient son mari, le respecte, et veille à une bonne éducation tant occidentale qu’africaine pour ses enfants. Elle ne ménage aucun effort à suivre son mari pour des séjours en Afrique, ou pour envoyer les enfants auprès de « Mamie d’Afrique » pour les vacances. En bonne épouse, elle aime sa belle-famille et s’y attache. Elle représente la valeur que devraient avoir les Hommes les uns envers les autres, au-delà de leurs antinomies ethniques, culturelles, et surtout leurs disparités de couleurs.
Nombreux sont les autres personnages qui sont activement comme passivement intervenus dans cette œuvre que ce soit Baï, Calixte, Comlanvi, Xwansi, Missalée, Anani, Oké, Kokou, Dr Dovonou, Dossi, ou Joseph Aïna, etc. que nous ne pourrons finir de présenter.
Etude thématique
- La culture
Moult sont les approches de clarifications qui ont été faites du terme « culture », et multiples sont les sens qu’elles peuvent prendre. Dans notre conteste elle est conçue comme l’ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation ; l’ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Dans ce sens, la culture peut être prise comme l’essence la plus caractéristique d’un individu et d’un groupe.
En effet, selon l’UNESCO, « la culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ». De cette définition, nous pouvons retenir que la culture est la pièce d’identité de tout individu, d’une société. Cela implique donc la relativité de la culture, puisque les réalités varient d’une ère à une autre, d’une civilisation à une autre. Ainsi, la culture se révèle comme un joyau précieux que tout individu voire toute société se doit de protéger et conserver puisque c’est en cela qu’il ou elle se distingue des autres. Par conséquent, la culture ne saurait être, comme on le dit souvent, « ce qui reste quand on a tout oublié » ; elle doit plutôt être entrevue comme le pense F. FAYOMI « le tout dont il ne faut rien oublier… l’âme-personnalité du corps social d’un peuple, son souffle identitaire… », in Lumière sur le développement culturel, Cotonou, Star Editions, 2005, p.90.
Dans cette œuvre, l’auteur commence par montrer à quel point il est jaloux de ses origines en prouvant le degré auquel il est prêt à vanter sa culture, son identité à travers religion et langue déjà dans le titre « Les appels du Vodún » ; religion parce que le Vodún en est une, et langue parce que Vodún est non pas en langue étrangère mais en langue fᴐn, langue de ses origines. De plus, l’obstination de l’auteur à écrire les noms de personnages, des lieux dans les langues locales « Daágbo, Fofo, Tánnyì, nylᴐ, Kpassɛ Zunmɛ, Yɛhwenᴐ, Nᴐví, Ԑɛn, Hùnxwé » (Grand-Père, Grand-frère, Tante, Oncle, Forêt de Kpassè, Prêtre- Vodún ou Prêtre catholique, Frère ou Sœur ou Cousin ou Cousine, Oui, Couvent), ou des expressions ou phrases entièrement retranscrites en langues locales « Ԑ ná cɛ, vì cé » (P. 287) ; « Asùsìcè » (P. 293) ; « Émá nyí mᴐ à ᴐ Ablawa na nyɛ yonu mí lέlὲ dó xwé ᴐ » (P. 334) etc. traduit non seulement son attachement à sa culture, mais aussi sa volonté à transmettre cet attachement à l’Africain, le Béninois qui se doit d’être jaloux de sa culture, son identité qu’il urge de protéger et promouvoir à travers les âges. « Chrétien, je le suis ; je précise même : catholique ; n’empêche, je ne blâme ni ne juge les confréries, animistes ou païennes, comme vous voudrez, authentiquement de chez nous, qui, je dirais, nous font toucher du doigt la réalité du tissu de notre terre. » (P. 158)
La culture, celle présentée dans l’œuvre, a été parcourue dans presque tous ses détails que ce soit sur le plan éducatif, culinaire, et religieux etc. que l’on ne saurait finir d’apostropher.
- Le culte Vodún
Religion endogène de l’Afrique, et plus particulièrement de l’ex Dahomey, le Bénin, le culte Vodún rassemble toutes les pratiques traditionnelles au moyen desquelles les ancêtres, surtout noirs, adorent l’Être Suprême ; cette Intelligence qui, selon eux, est créatrice de l’univers.
Loin d’être de la magie, pire la magie noire, encore moins le culte du diable et ses démons comme pensent d’aucuns, le Vodún désigne l’ensemble des forces surnaturelles et réceptacles à travers lesquels se manifeste le divin Créateur, Dàdá SԐGBÓ LISSA, Mahu – Celui que plus rien ni personne ne dépasse. Ainsi, selon l’entendement des aïeux, appréhender ces forces et réceptacles et les entretenir à travers le respect et la vénération qui leur sont voués, c’est tendre vers l’Être Suprême, c’est nouer et entretenir le lien de « Créateur et créés » avec Lui ; ce qui va bien évidemment avec ce que l’on pourrait donner comme définition au terme religion qui, du latin religio, désigne les pratiques à travers lesquelles l’être humain tend vers Dieu et noue un lien avec Lui. Les pratiques religieuses relevant beaucoup plus de la culture, elles sont susceptibles de varier d’une civilisation à une autre, et d’une époque à une autre. Toutefois, cela reste loin de constituer une raison de mépris, car au-delà de la meilleure manière d’adorer Dieu qui pût être recommandée pour être adoptée, il y a l’identité culturelle qui ne saurait être objet de rejet, de déni. Et c’est bien dans cette logique que l’auteur de l’œuvre expose comme il le peut, cette richesse aussi bien religieuse que culturelle que constitue le culte Vodún. Déjà à partir du titre, et ce jusqu’aux dernières lignes de l’œuvre, le Vodún n’a pas manqué d’être valorisé, magnifié dans tous les sens possibles. Le Vodún, tout comme l’Islam, le Christianisme, le Bouddhisme etc., doit être pour chaque Africain, un symbole d’unité, de paix, et un creuset de liens forts entretenus avec Dieu et le prochain, ou à défaut, une identité culturelle que l’on doit préserver jalousement au risque d’exister sans identité. « … alors, fofo, vous devriez aider l’Église à christianiser notre pays… », « -Pas au détriment des valeurs culturelles, je dirais mieux, des valeurs cultuelles et des convictions spirituelles de notre peuple. » (P. 158) ; « Quelle acculturation ! l’abysse en est affligeant car vous cherchez ailleurs des arguments pour réfuter les croyances de notre pays mais écoutez-moi bien : la sensation des choses étranges même du pays natal et leur compréhension ne rendent pas étanche aux progrès du monde moderne ; pas plus que l’absolue acceptation de l’archaïque, le misonéisme ne rendra personne heureux ; oui la vérité et sa pratique doivent l’emporter sur les compromissions qui font ramper » (P. 159).
Tout comme toute autre religion, le culte Vodún à travers ses préceptes, ses interdits, ses hymnes qui véhiculent tant de sagesses que de dénonciations et d’avertissement contre les mauvais us, ses rituels etc. ne manque pas de dénoncer les mauvais us de la société, de les réprimander, tout en promouvant les grandes valeurs les plus recommandables pour un être humain, un bon citoyen. Et c’est en cela que la crainte de s’attirer la colère des divinités Xèviosso (le feu ; dieu de la foudre), Gú (dieu du fer), Dan (le serpent ; dieu du vent ou de l’air), Tᴐxᴐsú (dieu de l’eau), Sakpata (la variole ; dieu de la terre), etc. fait que chacun se réserve de violer les lois de la cité, et s’efforce d’être modèle : une bonne manière pour garantir le respect des règles de la société et de garantir les droits de l’Homme.
- La mort et le respect des morts
Définie comme l’extinction des facultés physiques et mentales d’une personne, la mort est un phénomène qui met fin à la vie d’un être humain sous le soleil. La mort a toujours inspiré la peur, un événement malheureux. Mieux, elle a presque toujours été perçue comme une grande malédiction. Or ce n’est rien d’autre que le passage de l’âme à une autre étape, dans un autre monde – mieux que l’actuel. Le philosophe dira que c’est la libération de l’âme pour le monde réel, le monde intelligible ; pour le chrétien c’est le rappel à Dieu le Père ; et pour l’Africain, le Béninois c’est le retour vers les ancêtres, l’admission à la grande Cour des aïeux. Ce qui semble être de la superstition, est pourtant une croyance qui n’a pas manqué de se prouver de plusieurs manières en Afrique et surtout au Bénin. « Les morts ne sont pas morts. Ils ont rejoint les ancêtres, et sont toujours là avec nous. » sont souvent les mots que nous emploient les aînés pour nous apprendre à appréhender le fait et à porter un noble respect à la mémoire de tous ceux qui sont morts non seulement dans la manière de les inhumer mais aussi dans les souvenir que nous portons d’eux. « … on vit avec les morts, on dort sur leurs sépultures, à coup sûr protégé pares les esprits des morts » ; « la conviction ethnique l’affirme ‘’leurs âmes sont là éternellement et les Gléxwévijiji n’ont pas peur de la Mort » (P. 83). Des témoignages et des expériences vécues pousseront à soutenir l’idée que « l’on peut revoir une personne déjà décédée » sans pour autant être ni en rêve, ni en hallucination. Et l’expérience de Toinou dans l’œuvre quand on pense qu’il délit en déclarant avoir tantôt vu Grand-maman – qui était en compagnie de Yaga, sa mère, Tánnyì Bonin, sa tante et son frère Akpôtô, tous morts trente ans plus tôt et l’accueillent dans la maison ancestrale où ils furent eux-mêmes enterrés – (P. 29-30), est loin d’être de la démence : il a bien vu les morts.
A travers cette œuvre, loin de nous demander d’être des fatalistes, l’auteur nous appelle à appréhender le phénomène de la mort à la manière de notre culture qui ne dramatise pas le fait. Mieux il faut prendre la mort comme l’heure de rejoindre les ancêtres et s’y apprêter en faisant le bien afin d’y bénéficier d’un accueil digne du nom. D’un autre côté, l’identité culturelle passe par la tradition, voire même le respect dû aux ancêtres. Déjà dès leur décès, de par la manière de traiter leur corps, les cérémonies indispensables et les rituels particuliers qui doivent régir leur mise en terre et l’après leur mise en terre. La nuit profonde dans les rues « … on ne toussote pas, on retient son souffle : c’est peut-être un mort qu’on vient de croiser, il ne faut pas regarder en arrière ; une odeur fade : quelqu’un vient de mourir ; non, l’âme en errance d’un défunt qu’on n’a pas encore inhumé ; la phosphorescence de trois lampyres la guide vers la Porte des Morts qui va se refermer sur elle, … » (P. 83). L’auteur donne l’exemple quand il s’assure, bien que chrétien intellectuel, de veiller à ce que chaque étape des cérémonies requises pour l’inhumation de sa génitrice, Prêtresse du Vodún, soit respectée selon les préceptes de la tradition ; « La mise en bière aura lieu à Cotonou, si…la confrérie des Vodúnsi n’en décide pas autrement ; c’est à Gléxwé que ma mère sera inhumée. » (P. 37) ; et la cérémonie elle-même qui ne fera exception à aucune règle (cf. Chapitre LX-LXIII P.481-510).
- Des thèmes comme Sous-développement, Chômage et Délinquance, Exploitation politique, Réalisme et Surréalisme, sans ravir la place des thèmes principaux, n’ont su se faire prier dans une telle œuvre qui plus est, un joyau du « Patriarche de la Plume béninoise».
Analyse
A la lecture de l’œuvre, on se rend compte d’une similitude des réalités d’autres œuvres qui s’attèlent à camper leurs récits en Afrique, sur la terre natale. Si Kenneth Harrow pense qu’elle est digne d’être la suite logique de l’histoire de « L’enfant noir » que Camara Laye a manqué de donner, je peux, pour ma part, encore mieux dire en situant le lien au niveau de la nouvelle « La naissance d’Abikou » du même Olympe Bhêly-Quenum.
En effet, le nom d’Abikou qu’on n’aura pas découvert dans la nouvelle, nous sera dévoilé dans « Les Appels du Vodún » : Agblo Tchikôton. « Des frissons de désarroi parcoururent Yaga qui paniqua : sans les scarifications, cérémonies appropriées, décoctions de feuilles, de racines, de rhizomes rares qu’on lui faisait boire pour l’empêcher de rejoindre son frère et sœur jumeaux morts en bas âge dont il était l’incarnation et qui ne cessaient de le réclamer, son Agblo, abìkú difficile et fragile à la fois, ne serait plus de ce monde … » (P. 79). Ces passages de l’œuvre qui sont des flash-backs sur son enfance, attirent tout de suite l’attention sur ce que Agblo Tchikôton serait personne d’autre que la version adulte du fameux Abikou dans « La naissance d’Abikou ». Les mêmes personnages, à la différence des noms, se retrouvent dans cette œuvre-ci pour animer la belle histoire qui a commencé par la naissance d’Abikou, je dirais mieux Agblo Tchikôton, qui passera par « Une grande amitié », l’histoire de « L’initié » etc. ; ces récits qui présenteront plus ou moins invraisemblablement le parcours du petit Abikou, dirais-je Agblo Tchikôton, ayant étudié en terres étrangères et y vivant, sans pour autant oublier d’où il vient, qui il est réellement. Une suite qui montrera ce qu’est devenu Abikou de « La naissance d’Abikou », et ce lien étroitement particulier qu’il a, dès le sein de sa mère, entretenu avec cette dernière, à qui l’on peut rapporter les traits de Vicédessin dont il est ici question de l’inhumation.
Une telle façon d’entrelacer les histoires de plusieurs œuvres, et ce sans amalgames ni accidents thématiques, faire revenir les personnages et les muer d’un ouvrage à un autre, transmettre la réalité au moyen de l’imaginaire sans pour autant dénaturer le réel, ne peut que se réclamer du style ‘’quenumiste’’.
Et si l’on devrait imaginer une autre suite ?
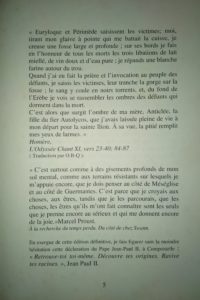
Coup de cœur
Mon coup de cœur pour cette œuvre réside dans sa nature unique. Une œuvre hors du commun, avec un style d’autant hors du commun. Non seulement elle semble détonner dans l’harmonie thématique que formaient les œuvres de l’époque, mais elle apparaît comme une figure de style dans l’ensembles des travaux de l’auteur. Comment exprimer l’enthousiasme, la palpitation, le frisson et la fièvre de joie qui vous emparent lorsque vous dévorez insatiablement une ligne par ligne, mieux, mot par mot, que dis-je lettre par lettre, vous présente, vous dit, vous livre vos origines, votre identité, qui vous êtes !? Les mots d’une langue étrangère ne le sauraient exprimer à sa juste valeur. Chez nous on dira Kpakpa nᴐ sᴐ mi, bᴐ avivᴐ fún nᴐ bla mi. É nan cὲ nú we Daá Gbêli Xwénú.
Conclusion
Après ce petit voyage à travers une si belle œuvre, multiples sont les appels qui résonnent aux téléphones de nos esprits. Il urge que nous aimions et valorisions notre identité culturelle, notre seule et réelle essence sans quoi nous n’existons pas ; que nous fussions intellectuels, analphabètes, musulmans, chrétiens, animistes et j’en passe.
En voilà une œuvre qui, contrastant son époque, n’a pour objet ni procès du néocolonialisme, ni l’impérialisme, ni dépravation des mœurs, ni aucun des thèmes communs qui font couler toutes les couleurs d’ancres ; comme pour rappeler aux Africains qu’il serait une gravissime erreur si, en ne s’attelant qu’à la répartie des infinies querelles de couleur de peaux, de tribus, de terres, de rancœurs, de haine etc., ils en arrivent à perdre leur plus grande richesse, leur identité culturelle. Mais elle n’a pas manqué de dénoncer néocolonialisme et maux dont est toujours victime l’Afrique ! : ce ne fût pas une œuvre du « Patriarche », comme d’aucuns l’aiment à appeler !
Eh bien, quand il faut lire Olympe Bhêli Quenum, un plaisir sans pareil est toujours ressenti quand bien même il s’assure de vous darder en dénonçant les maux et mauvais us dont on ne cesse d’être fidèles acteurs sur le continent Noir. Toutefois, loin d’être des recueils des tares africaines, ses œuvres plongent dans le vrai monde que représente l’Afrique à travers ses richesses on ne peut plus incommensurables.
Quelques paroles fortes
« Les choses importantes requièrent qu’on les expose sans mystère » (P. 10)
« La route barrée par la force des choses ne reste pas toujours impraticable » (P. 11)
« Fassent les dieux qu’il y ait toujours quelqu’un pour prier pour les autres » (P. 18)
« Il n’y a pas de honte à louer la gloire de Dieu, ni à danser pour lui ; c’est ainsi que nous lui montrons notre cœur, en tâchant de lui faire ouvrir le sien à nos problèmes » (P. 40)
« L’Afrique se cadavérise, c’est une évidence mais qu’on n’accuse pas seulement le colonisateur ! Observez l’empressement de tout quidam, enfant de notre pays, à mettre à l’abri en Europe ce qu’il soustrait des biens de sa terre natale ! » (P. 65)
« Le temps n’est pas encore venu où nos administrateurs de la culture comprendront que défense et affirmation de la culture, j’entends par ces termes la mise en valeur de l’essence de notre culture, sont au-dessus des prétentions des incultes commis aux Affaires culturelles de ce pays » (P. 66)
« Comme le pêcheur dans sa pirogue jette son épervier sur un banc de poisson, la mainmise du Vodún sur ses élus se manifestait par la transe et ‘’la chose’’ s’emparait d’eux là où la divinité le voulait » (P. 279)
« Nul ne devrait faire grief de son lignage à celui qui en a » (P. 394)
« J’appartiens à un milieu dont les membres, jamais, ne regardent en arrière ; c’est aux chiens qu’il arrive de retourner à leur vomi » (P. 394)
« Il faut avoir le courage, la dignité et la fierté de demeurer qui l’on est, un être de sa race, de ses origines, de sa lignée aussi, quelle qu’elle soit » (P. 392)
« L’innocence est une arme dont les ressorts sont dans la main des dieux. Ԑɛn… quiconque naît sous un signe de puissance en détient les secrets par innéité et il faut se méfier de tout homme tant qu’on ignore le signe sous lequel il est entré dans ce monde. Ԑɛn… c’est pourquoi nul ne doit charger un autre d’une faute qu’il n’est pas sûr que l’accusé a commise. Malheur à qui s’en prend à celui dont il méjuge de la force » (P. 393)
« Le monde évolue, il ne faut pas rejeter tous les progrès qu’il propose » (P. 438)
Kpossi Codjo Paterne HOUNKPE est né le 15 Avril 1996 à Bopa et y a fait ses études primaires. Après les études secondaires au CEG BOPA et dans les séminaires d’ADJATOKPA et de PARAKOU, il poursuit actuellement ses études en Administration Générale à l’ENAM, à l’Université d’Abomey-Calavi. En plus d’être passionné de l’art écrit, il est aussi un amoureux de l’art musical.