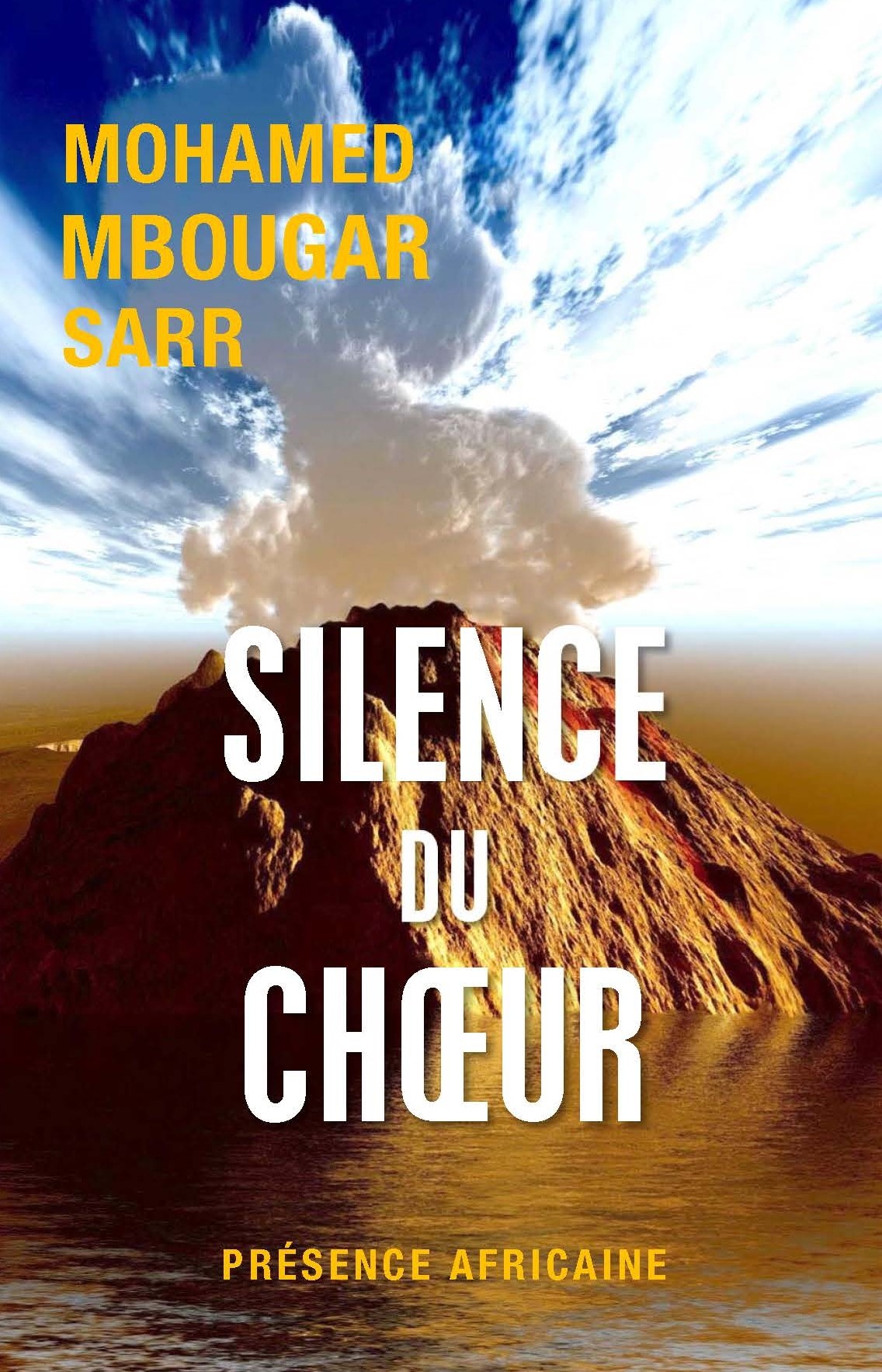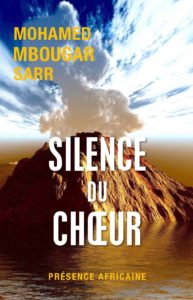 « Silence du chœur«
« Silence du chœur«
Il était une fois,
Les étrangers. Plutôt les ragazzi, pour les siciliens.
Il était une fois,
Un récit humain raconté par un poète déchu. Un long poème de la misère humaine. Le grand poème au chœur d’Altino, cette petite ville « accueillante » de la vieille Sicile.
Il était une fois.
Sabrina, Santa Marta, l’association ; L’hospitalité.
Maurizio, les calcagno, le droit de s’opposer à l’hospitalité.
Il était une fois,
Et surtout…
Un silence bruissant de chœurs : les échantillons de la misère humaine.
Alors,
« Silence du chœur », deuxième Roman de M. Mbougar Sarr n’est pas une tragédie humaine. C’est une illusion humaine. Ces hommes (étrangers et siciliens) au destin (désormais) commun, pourtant aux corps si différents, condamnés à faire un petit bout de chemin ensemble. Ces hommes, ensemble, marchent dans “un même espace…(en horizon se dessine la perspective d’un avenir commun, quel qu’il dût être…peu de choses…peut-être déjà tout…” (P.55). C’est l’histoire de ce monde aux portes de l’enfer comme cette équipe italienne qui a subi une longue descente aux Enfers (P.14).
Quelle est donc cette histoire des grands hommes entre Altinos d’Italie et ragazzi (étrangers) que nous raconte « Silence du chœur » en 415 pages ?
Moustapha Harzoune (Dans Hommes & Migrations N° 1322, pages 214 à 215) a dit, l’ambition : “réunir les destins, entremêler les vies de ceux qui débarquent et le quotidien de villageois siciliens, confrontés à l’imprévu, à l’étrange, à l’exceptionnel. Ils sont 72 rescapés africains recueillis par une association humanitaire. Tandis qu’ils attendent (s’impatientent) de connaître leur devenir administratif et juridique, le village se divise, se crispe : la suspicion et le rejet des uns grondent quand la lassitude, la crainte gagnent les autres. Jusqu’au coup de théâtre final.”
Ils attendaient : les dates de commissions (pour se régulariser) (P.247). Ils devaient attendre. Quelque chose. “C’était comme ça : attendre. Alors, ils attendaient bouches ouvertes face au vent, pareils à ces gros sauriens que l’on voit sur la berge de la rivière…” (P.248). Ils attendaient, chantant la tristesse, parfois sous les railleries et moqueries des calcagnos (P.280). Chanter. En chœur. Une mélodie : la musique de l’universalité, l’universalité du langage humain. C’est ce langage originel, la langue unique, une seule langue que parleraient tous les hommes (P.40) qui provoquait “un séisme mortel” qui a pu réveiller Jogoy quand l’octogénaire aveugle le padre Bionnano (P.52), polyglotte (P.90), le curé de la , lui parla en Sérère (langue locale du Sénégal d’une des nombreuses ethnies du pays). Jogoy, l’interprète, l’ancien ragazzo, est un des atomes de cette universalité des chœurs. Ce Dieu de l’homme (européen) inconnu de la civilisation occidentale n’est-il pas le même que celui des animistes du peuple de Jogoy (Rog) qui bouleversait tant le père Biannano durant sa mission civilisatrice chez les sérères où il fut entretenu de chants de griots lors de certains rites initiatiques auxquels on lui permit d’assister (P.93). Qui ne fit-il initier ? Car l’initiation est le langage humain le plus abouti ; la mémoire humaine. C’est tout cela : “le grand bruit de talons contre la terre pendant les danses…de corps en corps, de cœur en cœur…”(P.99). Le langage humain, est aussi dans le premier homme cet échantillon nu, ce ragazzo originel qui découvre l’Europe par la nudité de l’homme (P.108).
Bref…
Il était une fois…
Alors…
Et surtout…
La détresse d’hommes. Des hommes. La voix des chœurs, de l’aveu nu de la vérité, cette sincérité du cœur, “le récit des causes du départ, des frustrations en terre natale, des perspectives mortes, des espoirs morts, du chômage promis, de la tentation du grand voyage, des dilemmes moraux, de la décision prise aux confins de l’insupportable…” (P.189).
C’est comme ça que le poète imagine le drame humain avant que la lucidité, la folle lucidité, l’égoïsme et l’indifférence de l’Artiste (P.334) ne viennent lui souffler la froideur de l’analyse. Il doit s’atteler : dire les voix qu’on lui a léguées. Il en est un simple dépositaire.
Si bien dire…
Si ne rien dire….
Disons…
Ceci…
« Silence du chœur », est un récit de voyage. Une longue polyphonie. Plusieurs voix interviennent. L’œuvre a un caractère protéiforme : il s’agit de la diversité des points de vue de la narration à la troisième personne saccadée de passages narratifs neutres, une sorte de focalisation zéro. Quelles sont donc ces voix qui composent le récit à côté du narrateur permanent ? Elles seraient de deux types.
La voix des locaux
Mattéo Falconi, force de la paix (capitaine) a alerté : il avait assisté à quatre accueils de Ragazzi aux côtés de l’association Sante Marte, mais celui de cette année est assez particulier (P.74) Maurizio Mangialepre, opposant à l’accueil des ragazzi, peut compter sur ses cousins Sergio et Fabio pour mettre en jeu son plan (pari) (P.78) contre l’association et tous ceux qui entendent offrir l’hospitalité aux étrangers.
Par les inquiétudes du docteur Pessotto, médecin et entraîneur de l’équipe de football des ragazzi (une équipe de championnat local recrutait ses joueurs chez les réfugiés). Lui qui voit venir le tragique : “non ce qui se passe, mais ce qu’on sent qu’il va se passer. C’est comme la mort. Certains patients meurent dès qu’ils sentent que ça arrive. Avant même que le cœur ou le cerveau ne s’arrête.” Il sait. Le docteur Salvatore Pessotto. Il sait bien : rien n’ira pour le mieux pour les ragazzi et “qu’ils devront apprendre à vivre avec ça.” (P.115).
Les étrangers.
Par la voix de Fousseyni Traoré
Il avait senti ; Que ces hommes (Maurizio et les siens) “montraient des pancartes, disaient des choses pas gentilles, ne voulaient d’eux à Altino, leur petite ville (81). Rien ne leur sera donné. Ils devront, lui et les autres ragazzi, se mettre à l’Italien, respecter les cours, dire une bonne histoire (P.122) pour espérer avoir les papiers et du travail (P.121). C’est tout ça : le fantasme de l’Europe. Bemba s’interroge : “ça peut pas être ça l’Europe ! Pas possible. Pas possible que ce soit pour ça que j’ai joué ma vie dans le Sahara puis dans la mer. On nous cache quelque chose. Pourquoi m’a-t-on mis ici ?…ce foutu village. Où est le luxe ? Où est l’argent ? Où sont les jeunes et vieilles blanches qui aiment les Nègres et leurs gros bangalas veineux. Où est tout ça ?” (P.142). Que leur cache-t-on ? La vraie Europe ? Cette Europe gentille, souriante, mais pauvre et raciste qui offre des “vêtements, des légumes, des fruits, des provisions, mais jamais d’argent.” (P.144).
Si bien dire…
Si ne rien dire….
Disons…
Ceci…
« Silence du chœur », est un long carnet de voyage. Un récit d’hommes qui ont bravé la mort, les eaux de l’océan, cette mer “furieuse, si furieuse qu’elle se hérissa soudain, comme le porc-épic menacé dresse ses piquants, de grands rochers qu’on ne vit qu’au dernier moment. Ils semblaient avoir été plantés là par le dieu fâché de la mer.” (P.42). Jogoy livre : l’embarcation s’est fracassée ! (P.45). Avec froideur, Jogoy raconte les affres du voyage, de l’envers du décor de l’immigration (l’adjectif “clandestine” ne se risque pas ici !). Le ragazzo est catégorique : “Sans l’avoir vécu, personne ne peut s’imaginer ce qui se passe dans l’âme d’un homme perdu en pleine mer, qui espère voir des lumières mais dont le regard ne rencontre qu’épaisses ténèbres. » (P.105) Le désespoir, le sentiment d’être trahi finirent par avoir raison des voyageurs (trois d’entre eux précisément dans la pirogue où était Jogoy). Hatab n’est qu’un passeur de fortune. En vrai, il est un pêcheur. La sentence est sans appel : il est jeté en pleine mer pour avoir commis le crime originel, “le crime fondateur” de l’errance des voyageurs en mer (P.106). Qui s’intéresse au sort des infortunés ? “A la télé ou dans les journaux, on n’en parla pas très longtemps. Cela occupa un encart, un petit communiqué, l’espace d’un entrefilet…” Dire que l’on “s’accommode à la catastrophe permanente (…) Le drame que nous révèle l’horreur du monde est bien souvent celui qu’on finit par admettre le plus facilement.” (P.133). Jogoy en sera finalement le seul rescapé (P.112). Interrogé par le couple qui l’a recueilli chez lui au sujet de son départ, Jogoy ne se prive pas d’une réponse sèche et instantanée : “parce que je devais partir” (P.137). Jogoy, obligé de partir, partir pour ne pas mourir. Rester, c’était mourir. Mourir socialement, de honte, d’amertume (P.257).
Pour quelles raisons part-on ? Ne quitte-t-on le chez-soi douillet que pour des raisons économiques ? Y a-t-il réellement un chez-soi, un chez-nous ? L’étranger n’est-il pas celui qui finalement “relate et relie” (P.409). Ragazzi et siciliens ne se retrouvent-ils pas dans tout ce que humanité unissait (P.154).
Enfin, c’est grâce au carnet de que l’on sait ce qu’il s’est passé la nuit de l’honneur après la victoire de l’équipe des ragazzi (P.380 à 390). Six personnes meurent dans une rixe entre ragazzi-Santa Marta et les calcagnos. Jogoy livre la fin macabre d’une lutte sociale où le cœur était ces étrangers. L’ultime chœur de Jogoy fera basculer le roman dans la “langue de pierre” : “Qu’on me ramène parmi les chants et les cercles et les chœurs du ndût, seul lieu où l’âme guérit, seul lieu où la solitude n’existe pas, seul lieu où l’on sait de quoi on parle, seul lieu où l’on sait encore s’incliner devant le monde, seul lieu où la parole n’est pas perdue mais coule dans les veines du monde dont il est la sève et le sang.” (P.390).
Si bien dire…
Si ne rien dire….
Disons…
Ceci…
« Silence du chœur », est un récit dont le renouvellement du discours narratif n’a pas de limite esthétique. Autant, on peut se préparer à cette longue polyphonie diversifiée, autant l’incise du théâtre sur scène (venu de nulle part !) à la place d’un dialogue classique dans le roman (P.218). C’est à s’en foutre de la gueule du lecteur ! C’est une douche froide, ce genre de froid qui vous glace la lecture, confine le livre un moment avant vous que ne vous en rendiez compte. Mais bien sûr que vous n’hallucinez pas, ce que vous avez entre les doigts est bien un roman et non autre chose !
Bon, l’insulte est doucement inoculée dans le texte. Pardonnons, l’arrogance du romancier !
La courte pièce, “la piécette » de théâtre incrustée est composée de 05 scènes. La pièce est ce qui devait être entre Fousseyni et Lucia (la belle orange muette) un dialogue classique.
La voix du dramaturge installe le décor : “Appartement Fousseyni dans le salon. A gauche, une grande table à manger, à laquelle Fousseyni et Lucia sont assis. Dans le silence, un stylo court nerveusement sur une feuille de papier. Alors que Lucia écrit, on entend sa voix” (P.218). Il en est ainsi de la fermeture/ouverture de rideau imposée : “Lentement, la pièce plonge dans le noir. Lucia et Fousseyni disparaissent dans l’ombre. Une petite lumière s’allume, et éclaire la partie droite de la cuisine. Une grande femme noire s’y avance, un pagne ceint au-dessus de la poitrine. Sa beauté est d’une grande noblesse, malgré la souffrance qu’on perçoit dans ses traits et dans sa voix. C’est la mère de Fousseyni Traoré. » (P.219).
L’incise dramatique réservait une autre surprise dans le déroulement de la parenthèse dramaturgique. La folle idée du narrateur est de superposer une polyphonie en plein-de-dans de la greffe théâtrale. C’est la voix libre de la maman de Fousseyni : elle jure de couper le gros sexe épineux de l’oncle qui s’est glissé dans le lit du frère après sa mort (la pratique du lévirat est fréquente dans certaines sociétés africaines. Il s’agit de donner en épouse au frère vivant ou à l’un des frères vivants la femme du défunt. Le sororat est l’inverse). Cette maman éprouvée par la vie se réjouit que son fils, son Fousseyni (P.219), soit parti, car l’oncle, le mari parvenu ne l’aurait épargné de la mort s’il l’avait trouvé (P.221). Telle est l’économie de la scène 2. Fousseyni n’est donc pas parti à cause de sa mère/mais pour elle (scène 3). On n’oublie pas le petit clin d’œil au fantastique et au mystique avec ce serpent qui parlait à Fousseyni (P.223).
La scène 4 offre par contre une sublimation de la dramaturgie. Entre en scène Adama Kouyaté, le prince des poètes (P.225). Ce petit homme « vêtu d’un bel habit trois-pièces fait une entrée fracassante, d’une théâtralité majestueuse et un peu comique. Il prend la parole » (P.225). Dans la partition du prince des poètes, le fantastique sert à merveille l’épique et l’épopée. Il est question de la lignée des grands maîtres, de la légende des vieux ancêtres…! La force de la poésie est dans sa façon unique et symbolique de rappeler la lignée, quoique moins valeureuse parfois de l’initié qui part à l’aventure dans la peur. Kouyaté, le poète, a vu la peur dans les yeux du jeune Fousseyni et lui a chanté la gloire de ses “ancêtres Tarawalé” (233). Et que dire de la glissade entre les deux acteurs principaux de la scène, Lucia et Fousseyni ? Il appartenait à Lucia de finir le récit poignant de Fousseyni, le non surhomme, le héros d’une belle tragédie (235).
Au dramaturge de fermer le rideau : “Les deux s’étreignent (Lucia et Fousseyni) s’étreignent toujours. La lumière baisse lentement, jusqu’à l’obscurité. Rideau.”
Il était une fois…
Alors…
Et surtout…
Des amours inavouées. Des amours plates. Des amours sans passion. Des amours solitaires. Des amours impaires. Des amours réduites à leur forme la plus simple : platonique. On n’en parle pas assez, l’amour dans « Silence du chœur »,. Et pourtant, tout se joue à la fibre des sentiments. Le drame fatal (enfoui dans le cœur du récit) est le seul drame qui vaille d’être chanté en chœur : la haine de Maurizio envers Sabrina est un vieux passif, la seule dette insolvable : la dette du cœur. Maurizio cocufié par un ragazzo (Hampaté, fauché par une voiture, meurt plus tard le jour même où il obtient ses papiers dans les bras de Sabrina après un chaud baiser) en veut encore à Sabrina. Ce coup du destin, la mort du ragazzo qui lui avait ravi sa femme, ne l’avait pas calmé. Il l’avait enragé, bien au contraire.
Son opposition à la charité chrétienne de l’association n’est pas que simple élan patriotique et nationaliste. Après cet affront, le chef de l’opposition à l’Association jurait qu’il “ferait tout pour qu’aucun migrant ne puisse encore être accueilli par cette association qu’il avait un temps co-dirigée.” L’amant déchu, l’ancien accueillant, avait laissé place au saboteur, au farouche opposant…Il avait presque gagné, la haine avait presque vaincu mais il ne savait pas que la chute de Sabrina allait entraîner le sien. Sabrina est morte dans la bagarre au bar. L’annonce faite par le maire Montero (Du reste, la mort de Sabrina l’avait fait oublier celle de son cousin Sergio) l’avait plongé dans les profondeurs des abysses végétatifs d’où il peinait depuis peu, depuis son fauteuil (ce plouf plouf humain !) à émerger : il était un légume maintenant. Il n’était plus qu’un simulacre d’être vivant, un ectoplasme d’homme (…) Il ressemblait à une boule de papier qu’une main invisible et gigantesque broyait entre ses paumes.” (P.346). On n’oubliera non plus l’Amour sauvagement muet de Jogoy envers Carla. Il ne décidera d’en parler que dans sa lettre-testament. Carla est venue bien trop tard. Jogoy, son amour inavoué s’est jeté depuis sa balustrade dans le vide avant que l’Etna, le volcan ne broie la ville (P.402).
A l’opposé de cet amour impossible, violent, foudroyant, il y a l’autre grand amour du roman : ce sentiment dans toute sa pureté, dans sa naïveté, presque de l’amitié. Cet amour à son odeur propre : l’orange. C’est l’élan entre Fousseyni et Lucia, la fille-orange (P.59). Cette odeur poursuivra Fousseyni durant tout le récit. Une fois, Lucia lui tient la main. Il refuse de faire ses ablutions pour sentir l’odeur de l’amour, l’orange. “Dieu comprendra” dit-il (P.124). C’est cette belle odeur qui l’a réveillé des entrailles de l’Enfer quand le volcan mugissait pour calciner la ville. « Fousseyni pensait se retrouver en enfer, mais, une nouvelle fois comme lors de son premier réveil à Altino, ce fut l’odeur d’orange qui l’enivra.” (P.406). Cet amour n’est pas aussi rose que son épilogue veuille le laisser penser. Le seul rival de Fousseyni est mort dans la bagarre générale (Giani) tué par la lame intransigeante d’un Calcagno qui voulait violer Lucia. Quoi qu’il en soit, l’amour dans le roman s’achève pour son expression la plus violente : la mort. Qui aurait cru que Fousseyni tuerait par amour ?
Pour la fille-orange, Fousseyni a sauvagement tué. Il a frappé à l’aveugle (…comme un possédé…tel un forcené…mêlant son cri au beuglement de l’homme qu’il tuait, qu’il saignait, frappant et frappant avec une inhumaine sauvagerie…Il venait de produire le plus grand effort de sa vie…”(P.388). Pour l’amour. Pour la peur de perdre l’être aimé.
Conclusion
Choisir quelques angles de lectures : c’était l’objet de ce petit texte pour un roman si abouti. J’ai l’impression de n’avoir rien dit et pourtant si…Pourtant, il y en a beaucoup et peu à dire. Dire beaucoup risquerait de noyer le lecteur que je suis dans un pédantisme honteux. Dire peu le sauverait d’en avoir à dire encore et encore…!
« Silence du chœur », est ce genre de texte d’une ambition impolie que l’artiste dans un narcissisme inouï et dans une jouissance incontrôlable écrit au sommet de sa carrière. Le délire le happe et l’artiste se fond dans sa création. Cette façon de procéder oublie qu’il existe un lectorat, le grand public friand d’histoires et autres commérages !
Jamais, dans le nouveau roman africain, un texte n’avait poussé aussi loin la défiance technique et linguistique. Ni Kourouma lui-même ! Ni les autres ! D’ailleurs, Kourouma, Son “carnavalesque” révolutionnaire se ferait tout petit devant cet éclectisme narratif. Et s’il faut pousser la provocation plus loin, tant qu’à faire : C’est le premier “Grand Roman” de la littérature sénégalaise. C’est un roman total !
Pour les professeurs d’université, les doctorants, les petits curieux, des bourgeons de sujets peuvent susciter votre intérêt : Dieu, la foi/La déchéance du poète et/où de l’artiste/Le langage footballistique (pour les plus tentés)/la langue de pierre (pour les plus sournois)/l’opportunisme face à la misère du monde/ Coup de théâtre ou apothéose/… sans oublier les sujets de recherches qui tendent à l’universel…!
Il était une fois…
L’Etna.
Fantini.
Jogoy.
Vera et Vicenzo.
Bandino.
La statue.

Mamadou Socrate DIOP