« Vous saviez peut-être qu’il s’appelle Habib DAKPOGAN, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Il se livre dans l’interview qu’il nous accorde. « Habib Dakpogan, musicien et écrivain par nature, manager par besoin d’apprendre et de survivre, comédien par ignorance congénitale des limites. » Découvrez-le en mode HD »
________________________________________________________________________
BL: Bonjour Monsieur DAKPOGAN. Merci de nous avoir accordé cette interview. Voudriez-vous mieux vous présenter à nos lecteurs ?
HD: Habib Dakpogan, musicien et écrivain par nature, manager par besoin d’apprendre et de survivre, comédien par ignorance congénitale des limites.
BL: Vous avez suivi une formation pas du tout littéraire. A quel moment et comment avez-vous découvert le chemin de l’art musical d’abord, puis celui d’écrire ? Ecrire est-il tout aussi passionnant que chanter ?
HD: Oui j’ai fait une série C au collège et j’étais plutôt brillant. Mais il n’y a aucune corrélation entre la capacité à créer et la série scolaire. Il n’y a même pas de lien entre « être bien en français » comme on le dit communément, et l’aptitude à la création. Ce sont des idées reçues que de penser qu’en série A on se destine à la littérature. Donc moi j’ai toujours été artiste. Je l’ai remarqué à mon extrême sensibilité, à mon attrait pour les choses belles et délicates, à mon aversion pour la violence. J’interprétais facilement les chansons de la radio et de la télé. Et mon père jouait beaucoup de musique à la maison. Très vite j’ai su que j’allais être chanteur. Pour l’écriture c’est pareil. J’ai très vite développé une addiction pour la bibliothèque familiale et j’ai créé avec le voyage livresque un lien indéfectible.
Ecrire et chanter ? C’est la même passion : donner vie et faire voir. Il y a la même dose de peur et la même exigence d’audace.
BL: Avant d’aborder vos différentes œuvres, dites-nous ce que représente pour vous la famille, en ce siècle où tout est permis, légalisé. Quelles sont vos certitudes d’espérance que les familles, en Afrique, survivront à tous ces mouvements qu’on impose à l’humanité alors qu’on sait tous les désastres qu’ils sont en train de créer en Occident?
HD: La famille, c’est le laboratoire de la vie sociale. Tout se joue là. Tout ce que les années feront de nous, c’est à la famille que nous le devons. Notre résilience ou notre perméabilité à la pression sociale sont définies par la base familiale. Plus la cellule familiale est serrée, riche et consistante, plus l’individu est équilibré et confiant en lui-même.
Cela dit, il faudra faire attention aux postulats que nous brandissons. Personne n’impose rien aux familles africaines et les familles africaines ne sont pas dépositaires de la morale et de la décence. Nous avons certes de valeurs que nous devons conserver, mais nous n’allons pas non plus porter un jugement négatif sur les mœurs d’autres communautés. L’essentiel est de rester soi-même au sein de l’univers. Je ne parlerais donc pas de désastres, je parlerais de façons de voir. Si elles me choquent j’enseignerai à mes enfants selon ma vision des choses tout en faisant d’eux des personnes, ouvertes et tolérantes.
BL: Habib DAKPOGAN et Georges Brassens. Qu’est-ce qui vous brasse les sens? Une telle complicité ou filiation ne saurait être anodine…
HD: Habib DAKPOGAN et Georges Brassens. Sourire. J’aime le calembour. J’ai grandi dans du Brassens entre une multitude d’autres chanteurs. J’ai toujours été attiré par la verve, la bonté et le non conformisme, qualités rares qui ont séduit l’enfant que j’étais. Quand je parle de non conformisme, ce ne sont pas ces élans forcés qui consistent pour une personne ordinaire à tout faire pour paraître non conformiste, je ne parle pas de ces iconoclasmes autoproclamés qui relèvent plus de l’impolitesse que d’un pure nature d’êtres différents. Pour en revenir à Brassens, j’ai appris ses chansons par cœur et j’avoue que pour un enfant de 10 ans, c’était plutôt curieux. Le plus impressionnant c’est que les années n’ont pas émoussé ma passion pour le poète à mauvaise réputation.
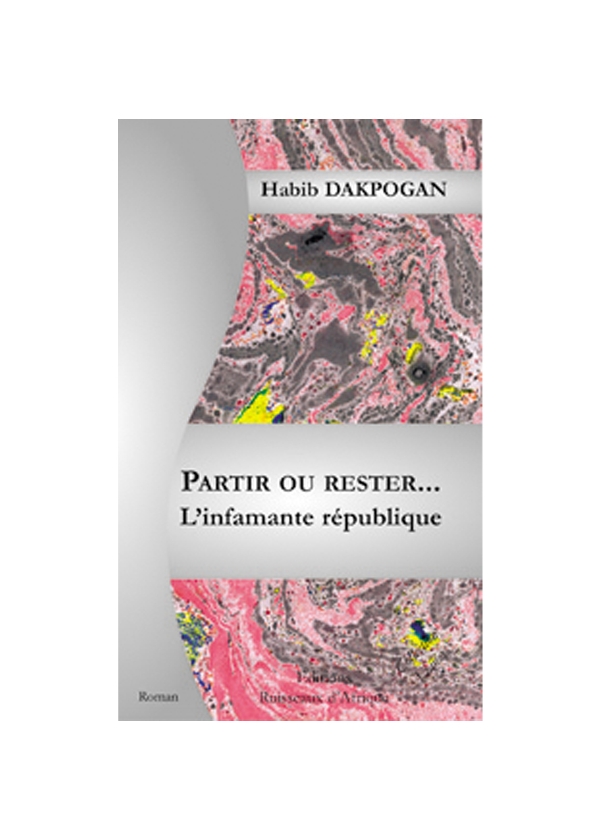
BL: Avec « Partir ou Rester… l’Infamante République », le premier roman qui affichera ou confirmera votre arrivée dans l’arène littéraire béninoise, vous vous insurgez essentiellement contre les déboires et les dommages vécus dans les administrations publiques de votre pays. Est-ce ce mal-être administratif qui vous a fait prendre plume ?
HD: Oui, en grande partie. Je n’en pouvais plus de voir passer ma vie et celle de milliers de jeunes, sans rien faire. Mais contrairement à l’idée dominante par rapport à ce livre, il s’agit plutôt d’un plaidoyer pour revoir les conditions de vie des fonctionnaires. La question est : Comment rester honnête avec un salaire de misère, en voyant les patrons voler sans être inquiétés ? La réponse est claire : collez la paix aux petits fonctionnaires que vous qualifiez de corrompus et revoyez le système.
BL: Dans votre second roman « PV Salle 6 » le registre dénonciateur n’est pas loin sinon que ce n’est qu’une suite des dénonciations faites dans le premier roman. Comment vous êtes-vous senti après avoir écrit la dernière lettre de ce roman?
HD: La dénonciation non. Je dirais la peinture vicieusement défavorable de certaines mœurs. C’est effectivement une sorte de suite plus développée de Partir ou Rester… Je voulais surtout écrire une œuvre dense et drôle à la fois. Je voulais prendre le prétexte du sida pour faire le tour des pantalonnades sociopolitiques auxquelles nous assistons impuissants. Quand j’ai fini ce livre, j’ai éclaté d’un grand rire, en me disant que je venais une fois encore d’entraîner le lecteur dans un dédale d’aventures rocambolesques. J’avoue que j’avais peur vu le volume, mais j’ai été heureux d’avoir fait un pas de plus dans le cœur des lecteurs.
BL: Avec votre recueil de nouvelles « Etha Contest » nous ressortons avec sans trop de mal votre verve à décrire ou à dénoncer les morosités politiques qui font fermenter le développement de tout un pays. Devrons-nous simplement nous résoudre à ce que vous avez pris la plume pour faire reculer cette floraison de la mauvaise gouvernance ?

HD: La mauvaise gouvernance est le reflet d’une mentalité qui perdure avec le temps et qui reste constante dans l’espace africain. Et la mauvaise gouvernance est le premier des fléaux qui maintiennent l’Afrique au Moyen-âge. Comment un ministre de la santé peut aller se soigner à l’Etranger ? Je donne ce seul exemple pour tout illustrer. Quand on y pense ainsi, ça fait sourire mais quand on a connu le Bénin profond une fois, où les gens sont sans eau, sans courant sans médicament, sans nourriture, on ne peut être que révolté face aux amusements et à la comédie au sommet de l’Etat.
BL: Dans vos œuvres, vous n’épargnez jamais le registre humoristique. Quelle place occupe le tocsin latin “Castigo mores ridendo“ dans vos écrits ?
HD: Sourire. C’est Nietzsche qui a dit que l’homme a inventé le rire pour tromper la souffrance, et c’est ce que je fais. Le message passe mieux que dans un essai. L’humour est un piège. Dès qu’il t’accroche, tu ne peux plus échapper au reste.
BL: Votre onomastique nous arrache parfois des bols de rires. Que voulez-vous cacher concrètement dans des noms tels que Nagasaki, Koweït, Djoguétchédo, Waterpolo ?
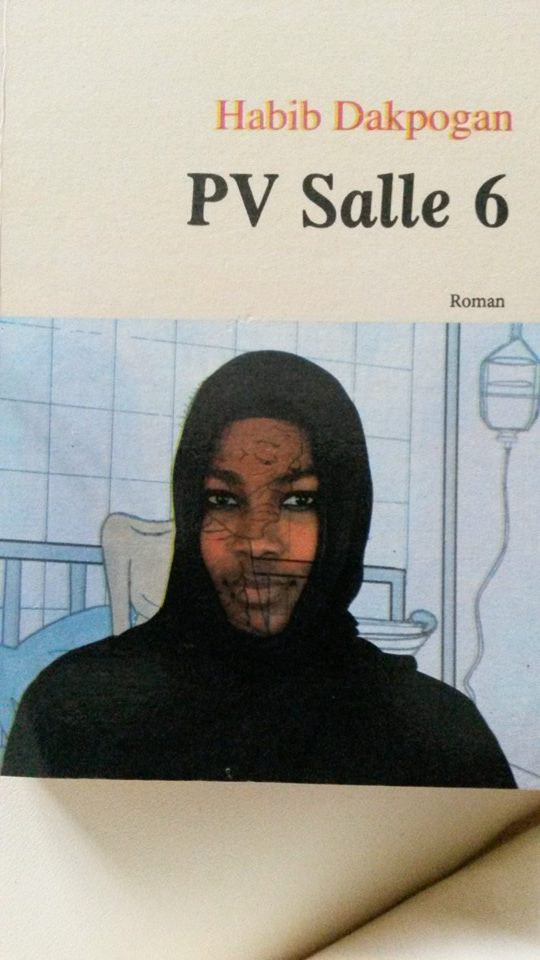
HD: Le premier des critères est que ça doit être musical. Et quand ça sonne bien et surprend par le caractère décalé et inattendu, ça me plait. Et quand ça me plait, je me dis que je peux avancer et me faire plaisir. La plupart du temps, quand l’écrivain aime vraiment ce qu’il fait, le lecteur suit.
BL: Quel est selon vous le rôle d’un écrivain dans un pays où les flics sont monnayeurs parce que se posent aussi le problème de pain et l’équation des élections à remporter quand on les organise soi-même?
HD: Il faut que la pensée circule. Tout part de la pensée. Il faut pouvoir structurer une pensée et la communiquer, en espérant que la communauté s’en saisisse et en fasse ce qu’il lui plait. Mon combat c’est d’amener chacun à méditer sur les actes de tous, et que nous Africains apprenions à penser par nous-mêmes, nous départir des idées reçues, nous libérer du joug des religions, des superstitions qui arrièrent, et échafaudent nos propres systèmes de pensée. C’est à ça que je m’attelle en écrivant des livres.
BL: Que fait le musicien lorsque le poète et le romancier s’expriment en Habib DAKPOGAN?
HD: C’est la même personne qui a plusieurs manières de façonner le réel en visant un réel encore plus beau. J’aime la musique africaine pour le rythme, la musique américaine pour la folie, la musique française pour la poésie, la musique anglaise pour la philosophie, les musiques ibériques pour l’harmonie des mots. Et tout ceci se recoupe dans ma façon d’écrire un texte et tout ça alimente à la fois le fond et la forme de ce que j’écris.
BL: Vous avez eu la chance sans doute de visiter d’autres littératures extérieures à travers vos voyages et participation aux salons de livres. Qu’a-t-elle, la littérature béninoise, à apporter aux autres ?
HD: Tout. Un art de vivre. Un humour. Des thématiques nouvelles. Le Béninois, celui là à qui les chansons traditionnelles ont enseigné la méfiance depuis son enfance, comment vit-il dans l’ère du numérique où il doit rencontrer des inconnus chaque jour ? Comment le Béninois gère-t-il la virtualité actuelle ? A quoi croyons-nous vraiment, nous qui portons des croix le matin et nous prosternons devant des vaudous le soir? Nous avons trop de choses pour étonner le monde à travers notre littérature. Et il faut aller justement à ces foras et voir les superstars de la plume drainer du monde, et se rendre compte qu’elles ne sont pas béninoises et se dire : le monde ne sait encore rien de nous. Nous avons tout à donner.
BL: Que vous inspire cette pensée d’Aminata SowFall: « Le désordre qui bouleverse le monde a pour cause l’aliénation collective. (…) Chacun refuse d’être soi-même et se perd dans l’illusion qu’il peut se tailler un manteau selon sa propre fantaisie. »? (Aminata SowFall, in L’Appel des arènes)
HD: C’est exactement ce que je disais plus haut. Il faut désintoxiquer l’homme noir des poisons dont le premier est le religieux.
BL: Vous ne cessez de décrier la soif et le pouvoir de l’argent. Que ce soit dans vos deux romans que dans « Etha Contest », votre cri est le même. Que faire finalement?
HD: Amener progressivement les politiques à se rendre à l’évidence que la gestion publique est un devoir sacré et non une opportunité pour devenir riche.
BL: Pensez-vous que le livre pourra vraiment nourrir son homme au Bénin ?
HD: Le livre devrait nourrir l’esprit d’abord et nous sommes encore loin de là. Quand prendre un livre sera le réflexe des personnes citées en modèles, plus de personnes seront touchées et il y aura une demande qui fera que les écrivains vendront. Nos hommes politiques ne citent personne, ils ne se gênent pas pour donner des discours brillants. Ils ne nous font pas rêver. Toute l’envie qu’ils donnent aux jeunes, c’est de s’enrichir.
BL: Vous venez de publier votre premier recueil de poèmes : « Dessins de silence ». Comment le silence arrive-t-il à dessiner où à se faire dessiner? Et quelle est la cible visée?
HD: C’est l’histoire d’un silence qui n’a que trop duré, depuis le départ pour le territoire des échos, de mon ami dessinateur Hervé Gigot, en 2010. Il devait m’apprendre à dessiner. Et comme il est parti sans prévenir, je me suis promis de faire des progrès en dessin pour pouvoir un jour dessiner les silences profonds qui nous séparent, ou nous unissent.
BL: De ce dernier livre, Buzz de Cotonou a dit : « DESSIN DE SILENCE » UNE OEUVRE SALUTAIRE. (http://buzzdecotonou.com/dessin-de-silence-une-oeuvre-salutaire/) Pourrait-on aussi y voir une œuvre de salubrité? Comment la poésie peut-elle aider à assainir aussi bien les corps que les esprits?
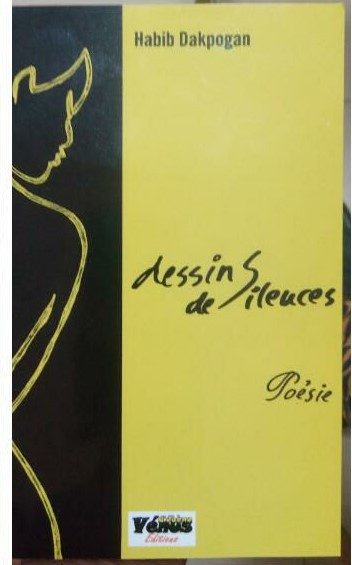
HD: La poésie appelle à l’élévation, au dénuement, à l’accouplement, ou au crime. Elle demande un détachement, un départ, une catalyse. Elle n’a pas la prétention d’assainir, seulement d’organiser une rencontre… avec nous-mêmes.
BL: Comment se passe la journée de Monsieur Habib DAKPOGAN?
HD: J’aurais bien voulu qu’elle soit une journée d’écrivain. Hélas, pour le moment il y a ce travail de manager de ressources humaines qui m’occupe 8 heures sur 24. Je n’ai que peu de temps et les weekends à consacrer à l’art. J’ouvre mes propres projets à l’heure de pause. Lectures, relectures de textes d’autrui, écriture. Ce n’est jamais suffisant puisqu’il faudra que je déjeune et que je me repose. Le soir, il y a la turbulence de mon fils (je l’adore), la fatigue de la journée. Je reste parfois travailler jusqu’à 4 heures et déjà à 6 heures et demi je suis sur pied pour être prêt pour le bureau. Ce n’est pas une vie de rêve, mais c’est le seul moyen que j’ai pour l’instant en attendant de me consacrer totalement à mes passions.
BL: Quels sont vos futurs projets pour la littérature béninoise ?
HD: J’ai quelques livres en projet. Tous ne sont pas de la littérature. Je travaille aussi sur de nouveaux défis littéraires. Je n’en dirai pas plus pour l’instant.
BL: Un mot à l’endroit des jeunes qui hésitent à prendre leur plume.
HD: Il faut déjà qu’ils aiment lire, qu’ils soient libres et qu’ils se rassurent d’une chose : l’art est le seul domaine où il n’y a pas de loi, ni de droit d’aînesse, ni de gendarmerie. C’est l’audace et la folie qui gagnent. Pas d’autocensure, mais beaucoup de lectures et d’exercices.
BL: Votre mot de fin
HD: Merci



