Alex La Guma, Nuit d’errance : un modèle de conciliation de l’art pour l’art et de l’art engagé.
Dépositaires de nos gouts et aversions, les souvenirs sont l’appui de l’esprit quand l’enveloppe une nuit épaisse. Les phares de l’avenir éteints, pour un temps on se replie dans la remembrance des plaisirs évanouis. Nombreux doivent leur survie à l’horreur à la mémorisation de vers ou de récits. Je ne possède malheureusement pas cette faculté, je suis plutôt hommes d’images. Celles-là se gravent sur mon esprit comme de la cire sur du papier. Mon adolescence expirait lorsque l’ouragan de la guerre emporta tout ce qui du point de vue l’esprit m’avait tenu compagnie : les livres, les disques, les tableaux. L’après-guerre me trouva loin de chez moi, privé de la chaleur d’un foyer, des êtres et objets qui me rassuraient et enhardissaient mon pas dans la ville où je vis le jour. Bien que la perte de mon socle habituel me chagrina, je m’accommodai tant bien que mal de mon éloignement. En partie grâce à la résurgence de temps en temps de l’atmosphère dans laquelle j’avais été élevé. Des disques et des livres familiers depuis l’enfance, comme des ombres amicales, me consolaient. Ma sympathie pour ces livres ne procédait pas de la lecture, car je ne les avais pas tous lus, l’avait enfantée une longue proximité. Dressés sur la bibliothèque paternelle, je les connaissais depuis ma plus tendre enfance, j’adorais les passer en revue, soupçonnant leur importance. Pour je ne sais quelle raison, une poignée d’entre eux, soit par leur aspect, soit par leur titre, se distinguaient des autres. Les épais volumes de Georges Duby, la couverture rouge de « Pas de lettre pour le colonel », « Ville cruelle », « Le livre de mon ami », « l’opium des intellectuels », les « Cahiers congolais d’anthropologie et d’histoire » et d’autres, dont la carcasse, mangée par les mites, pourrissant dans la poussière ou servant de papier à cornet aux vendeuses de cacahuètes, avait péri, revenaient me réchauffer. Depuis, animé par la nostalgie et le désir de restaurer les briques de cet édifice à jamais détruit, je les rachetai. Nuit d’errance d’Alex La Guma était du lot. Seulement, une autre raison motivait mon achat. De par l’intensité du plaisir qu’il m’avait procuré, ce livre avait instantanément complété la pile de ces ouvrages dont on fait des compagnons de vie.
Le soufre de l’Apartheid empestait par-delà son terme, les années de pax mandelae n’avaient pas complètement atténué les effets de cette période affreuse. Sa problématique fouaillait encore mon esprit lorsque je lus Nuit d’errance (A walk in the night) pour la première fois. Les chroniques radiodiffusées de ses horreurs, les vexations décrites dans le roman décolonial, l’échos persistant du mouvement des droits civiques aux USA, avaient déjà éveillé ma conscience. L’oppression, jusque-là, tâtée par le truchement de la fiction et de la télévision, me paraissait une excellente école sur l’humanité. M’attirait alors tout ouvrage susceptible de remplir la coupe de mon indignation en renseignant injustices et persécutions. Ma plongée dans Nuit d’errance s’accompagnait d’une espérance indécise de scandales. Or le mot errance n’augurait rien de bon à cet égard. La conjecture fut taillée en pièces. J’en sortis bouleversé. Mon affect endolori ne convoque pas mes larmes, mais Dieu sait que mon cœur saigna au bout de cette poignante entrevue. Je m’affligeai de savoir l’auteur d’une œuvre si prenante sous terre. L’outre-monde, par chance, ne censure pas l’admiration. Je lui en offris une avalanche. Bien modeste comparée aux stèles dressées par ses biographes et critiques. Des renseignements y attendent quiconque souhaiterait mieux connaître cette icône de la littérature sud-africaine. Il importe, du reste, de noter que chez lui l’écriture prolongeait l’action politique. Ce qui lui a valu, outre les emprisonnements, la censure et l’exil. Formidables trophées !
Publié en 1962 à Ibadan par Mbari Publications, Nuit d’errance présente au grand public l’investissement du littéraire par le militantisme de La Guma. L’aboutissement du roman révélait un écrivain accompli. Le travail de la langue, claire et sans apparence de labeur, le choix des symboles, la composition, profilent des préoccupations d’ésthète. Véritable ciseau, sa plume atteignait la précision des sculpteurs sur pierre qui ornèrent les tympans les plus remarquables des cathédrales gothiques. Son soin du détail en impose. Pris dans le piège de ce virtuose, on s’attarde sur ses descriptions minutieusement ciselées. Il faisait sans doute sienne la préoccupation formelle chère à Flaubert. Sur ces considérations, on peut postuler que l’action politique, matière de la plupart des écrivains emblématiques de son pays, ne fonde pas sa création. Si la révolte excite le génie, elle n’a pas enfanté celui de La Guma. Ce n’était qu’une contingence avec laquelle ses dispositions durent s’accorder. Cet homme eût charmé dans n’importe quel contexte. Rarement on a à ce point concilié finalité plastique et impératif de protestation. Partisans de l’art pour l’art et adeptes de la littérature engagée apprécieront l’harmonie du diptyque formé par Nuit n’errance.
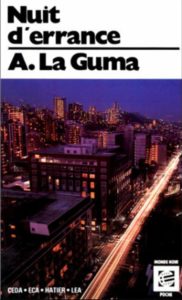
Le premier né de La Guma ne traite ni d’une grève de mineurs, ni de l’action clandestine de militants anti-apartheid, encore moins d’une marche de protestation. Sa focale resserrée exclue les grandes masses, impose un espace géographique et temporel réduit. Il relate l’errance à travers District Six, un quartier noir du Cap, de Michael Adonis, jeune métis limogé pour avoir voulu aller aux toilettes, dont le ressentiment culmine en un crime absurde. Willieboy, un jeune-homme noir de ses connaissances, est accusé à tort, puis tué par le brigadier Raalt, un policier raciste. L’équilibre entre l’élan créateur et la nécessité de la protestation réside autant dans les peintures qui agrémentent la progression des personnages que dans le glissement progressif de la banalité du quotidien vers la bascule du récit. Des portraits et scènes de genre détaillent District Six et son peuple. Les lieux et les objets, comme si une âme leur était insufflée, s’animent d’une présence supra matérielle. Ils contextualisent le roman, ancrent les personnages, les soulignent. Recouvrant le tout de son ombre, la nuit, accentuée telle une nuance picturale par l’opulence de son champ lexical, symbolise les noirs. En tout obscurs, aux horizons ténébreux, niés dans leur humanité. L’aptitude à surprendre élève davantage les auteurs dans l’estime des lecteurs, c’est le cas pour La Guma. Disséminées dans l’œuvre avec innocence, les indices de la marginalité, de la soumission et de l’oppression de ces « pauvres nègres » constituent des preuves accablantes de la barbarie de l’Apartheid.
Agencée avec l’ascension des marches d’un immeuble par Michael Adonis, l’intensification dramatique de l’intrigue s’accompagne d’un message implicite : l’humiliation engendre le ressentiment ; le ressentiment la colère, la colère la violence. On eût aimé que l’échos de ce message ne traverse pas l’effroyable 20ème siècle, mais aux prouesses technologiques de ce début de 21ème siècle ne répond pas une considération sincèrement progressiste de l’homme. La différence n’a pas cessé de justifier le crime et l’outrage, les personnages de Nuit d’errance s’incarnent encore jusque dans les démocratiques les plus avancées. Leurs questions, qui semblent échappées de la bouche consternée de ces afro-américains victimes de policiers négrophobes, demeurent d’une funeste acuité : « où est-ce qu’on a le droit de traiter un type comme ça ? […] Mon Dieu, on est tous des êtres humains, non ? ».
Philippe N. Ngalla



